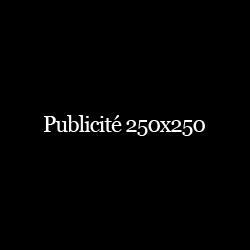Promotion 1924
La liste des officiers admis à entrer à l’École
supérieure de guerre en 1924 paraît au Journal
officiel du 27 mars 1924. La nouvelle promotion comprend 80
officiers : 41 viennent de l’infanterie, 10 de la cavalerie, 14 de
l’artillerie, 5 du génie, 4 de l’aéronautique, 5 de l’infanterie coloniale et 1
de l’artillerie coloniale. Avant l’entrée à l’École, les futurs stagiaires
accomplissent les stages obligatoires dans les différentes armes.
Les cours débutent le 3 novembre 1924. Vingt-cinq officiers
étrangers se joignet aux 80 Français.
Le chef de promotion est le chef de bataillon BEAU.
Les cours se terminent le 1er novembre 1926 ; tous les élèves sortent brevetés. Il n’y a officiellement aucun classement ; mais le colonel Pagézy, commandant en second, donne systématiquement, dans les notations de fin de stage, un aperçu de la place finale de chaque officier au sein de sa promotion.
Outre le « trombinoscope », quatre photographies de groupe représentant la 47e promotion ont été publiées dans un album consacré à l'ESG par l'éditeur d'art Sartony, 45 rue Laffitte, Paris.
Dix officiers de cette promotion sont morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale : DEMANGE, ROUSSELOT-PAILLEY et TACHET DES COMBES en 1940, GANDRE, JACQUIN, MOUGIN en 1942, MARANGE en 1943, DIDELET, FONFERRIER et MENUEL en 1945. Le général de corps d'armée DUVAL est mort pour la France en Algérie en 1955.
*
* *
Notes sur l'École supérieure de guerre en 1924-1926
par le colonel HALLIER
Article paru dans le bulletin trimestriel de l’association des amis de l’École supérieure de guerre
A l'époque, une promotion composée d'officiers ayant tous fait la guerre a trouvé dans l'enseignement de l'école la confirmation de ses expériences de la guerre vécue.
L'époque de la victoire était proche. Aucune inquiétude extérieure n'apparaissait. Aucun budget n'envisageait l'étude et l'achat de matériel nouveau. En bref, une morte saison peu propice à la recherche.
Nous avons donc sans soucis étudié l'ancienne guerre.
Il n'en reste pas moins que nous avions acquis des bases pour éventuellement remettre en question tous les problèmes militaires.
Profit tiré du stage.
- Excellente gymnastique pour un travail d’état-major. Applicable en temps de paix. Utile en temps de guerre à condition de s'adapter aux circonstances du moment.
- Pas de profit sur le plan stratégique. J'ai suivi ultérieurement en 1937 le cours du Centre des hautes études militaires, qui ne m'a guère orienté davantage.
- Sur le plan tactique, un enseignement un peu livresque, mais souvent utile.
Un stage en définitive utile à cause de l'effort des études. Les procédés de travail en salle recommandables.
L'acquisition la meilleure a été dans les échanges personnels avec les camarades des autres armes et avec certains professeurs que l'on connaissait individuellement.
Ma première année s’est déroulée sous le commandement du général Dufieux, personnage un peu gabarit et figé. Ma deuxième année était avec le général Héring, qui a cherché à secouer l'enseignement. Il n'a pas réussi entièrement, rencontrant des réticences à l'état-major de l’armée et au sein du corps enseignant de l'École.
Peu de professeurs étaient très marquants. Quelques-uns ont fait la deuxième guerre mondiale d'une façon marquée tel GRANDSART ou PICQUENDAR. Mais en général, des maîtres peu entraînants. A noter cependant :
- Le colonel TOUCHON, magnifique combattant, alpiniste célèbre, grand animateur.
- Le colonel CHAUVINEAU, sapeur, esprit original, conférencier subtil.
Les relations avec les stagiaires étrangers étaient généralement courtoises mais peu intimes. Il y avait néanmoins des cas d'espèces. Dans mon groupe, un officier iranien avec lequel nous étions en totale camaraderie, qui est revenu souvent en France et que j'ai été voir à Téhéran. J'ai le sentiment que beaucoup de stagiaires étrangers gardent un bon souvenir et une certaine fierté de leur stage à l'École supérieure de guerre.
S’agissant des stagiaires français, sans faire de généralisation, je ferai une distinction entre les officiers stagiaires mariés et les célibataires. L'époque était alors difficile pour les jeunes ménages. Logements rares souvent en banlieue. Ressources limitées. Enfants en bas âge. En bref, des problèmes privés limitent une activité intellectuelle lors des études immédiates. Beaucoup vivent en vase clos en famille et hors du monde extérieur.
Par contre, les célibataires ont eu des occasions d'échanges entre eux et avec des civils, de faire des voyages et pour beaucoup d'augmenter à Paris leur bagage littéraire et artistique.
Par ailleurs, les problèmes politiques absents des préoccupations de l'ensemble. Les conflits de générations inexistantes.
Gallerie Photos :