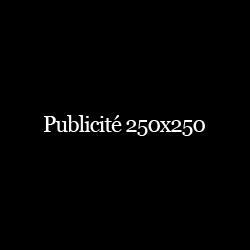LA FORMATION D'ETAT-MAJOR PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Comme lors de la 1re Guerre mondiale, l'enseignement de l’École supérieure de guerre est interrompu au moment de la déclaration de la Seconde.
Les stages d'état-major pendant la Drôle de guerre
Comme lors de la 1re Guerre mondiale, l'enseignement de l’École supérieure de guerre est interrompu au moment de la déclaration de la Seconde.
Les stages organisés à l’École supérieure de guerre à Paris
Un cours particulier d'état-major est organisé à l’École supérieure de guerre, du 11 septembre au 17 octobre 1939, au profit de certains des officiers admis en 1939, dont la scolarité, prévue à partir du 1er novembre, vient d’être annulée.
Afin de poursuivre la formation d’officiers d’état-major, un second cours est mis sur pied, du 20 novembre 1939 au 20 février 1940, à l’École supérieure de guerre, au profit de 75 officiers stagiaires dont quelques réservistes. Il est dirigé par le colonel CURNIER, avec pour adjoint le lieutenant-colonel AZAÏS.
Le centre d'instruction d'état-major de Compiègne
Un troisième stage, établi à Compiègne, débute le 18 mars 1940 sous la dénomination de centre d'instruction d'état-major ; il compte 144 officiers dont un tiers de réservistes et 14 officiers polonais dont 2 instructeurs. Les officiers d'active ont pour la plupart été admissibles en 1938 ou 1939 au concours de l’École supérieure de guerre ; les officiers de réserve sont en phase initiale de formation d’officier de réserve du service d’état-major. Le directeur est le lieutenant-colonel AZAÏS.
Lors de l'attaque allemande du 10 au 19 mai, les stagiaires subissent les bombardements croissants qui affectent la ville. Devant l’aggravation de la situation, plus particulièrement à partir du 14 mai, ils sont chargés de missions très diverses :
- Poste de liaison du Grand quartier général nord-est et contacts avec les grandes unités ;
- Equipes de garde, de surveillance et de régulation à tous les accès de la ville ;
- Organisation et encadrement de zones de regroupement pour les unités qui ont été bousculées sur la Meuse ;
- Préparation de la destruction éventuelle des ponts de l'Oise à Compiègne et de l'Aisne depuis Soissons jusqu’à Compiègne (14 au 17 mai).
Le dimanche 19 mai au matin, le chef du 3e bureau du GQG nord-est met fin aux missions exceptionnelles du centre d'instruction dont les personnels administratifs rejoignent l'École militaire tandis que les stagiaires et professeurs sont dirigés vers La Ferté-sous-Jouarre où ils reçoivent une nouvelle affectation.
Un article du colonel ROBERT détaille les missions imprévues du centre d'instruction d'état-major du 18 mars au 19 mai 1940.
La formation d'état-major dans l'armée d'armistice
Après l’Armistice, des expériences sont menées dans la clandestinité, en particulier au cours de vérification d’aptitude technique (CVAT) installé à Royat et au centre technique d'information de Lyon, sous les ordres du général BAURES, de janvier à novembre 1942.
Le lieutenant-colonel CHOMEL, chef du 3e bureau du 1er groupe de divisions militaires, dirige également, dans les locaux de l'Ecole du génie d'Avignon, un cours d’état-major camouflé sous un cours de transmissions. Les travaux pratiques ont lieu sur le terrain où stagiaires et professeurs se rendent à bicyclette.
L’année 1942 voit aussi l’organisation de cours d’état-major en Afrique du Nord, sous la forme d'un cours de vérification d’aptitudes techniques dirigé à Alger par le lieutenant-colonel BRYGOO, et à Rabat, sous la direction du colonel EON assisté du commandant THUAIRE.
Du 10 octobre au 1er juin 1943, un cours est également organisé à Hué en Indochine.
*
* *
Le premier cours d'état-major au Maroc (15 juin-29 août 1942)
Article du général BEZEGHER paru dans le Bulletin trimestriel des Amis de l’École supérieure de guerre n°42 (janvier-avril 1969).
Si l'encadrement des troupes françaises d'Afrique du Nord ne posa pas de trop graves problèmes - en raison du grand nombre d'officiers et de sous-officiers de carrière venant de France qui continuèrent à y affluer après l'Armistice, il n'en fut pas de même du fonctionnement des états-majors, et surtout de la préparation de ceux-ci pour de futures grandes unités, au cas de mobilisation et de nouveaux conflits.
Le nombre des officiers brevetés étant relativement réduit, il fallut faire tenir de nombreux postes dans les bureaux des états-majors de territoire ou de divisions territoriales par des officiers de troupe qui, de façon générale, surent s'adapter et se révélèrent efficaces, mais il devint rapidement évident qu'il fallait les préparer à jouer leur rôle en cas d'opérations actives.
Les accords d'armistice interdisant toute préparation de cet ordre, le haut commandement des forces terrestres en Afrique du Nord dut se résoudre à permettre à chacun des trois territoires d'entreprendre cette formation avec le maximum de discrétion, à l'insu des commissions d'armistice allemande et italienne.
En ce, qui concerne plus spécialement le Maroc, rappelons pour mémoire que les effectifs y autorisés s'élevaient à 24 793 européens et 22 000 indigènes, mais qu'avec l'appoint des formations de défense dites territoriales et des troupes rapatriées du Levant ils finirent par atteindre vers le 1er novembre 1942 près de 55 000 hommes.
Le commandant supérieur, le général LASCROUX, décida dès le début de mai 1942 la création d'un cours d'état-major, qui s'échelonna sur onze semaines à partir du 15 juin, pour 24 officiers stagiaires des différentes armes.
Les sept premières semaines furent occupées par des conférences et des séances d'information dirigées par les officiers des bureaux de l'état-major des troupes du Maroc de Rabat, de courts stages d'armes et des exercices de cadres en salle ou sur le terrain - avec même un exercice pratique à bord du croiseur Primauguet, pour se terminer par la présentation d'un tabor, à effectif complet.
Dans la huitième semaine, les stagiaires furent répartis en quatre groupes qui allèrent renforcer des états-majors de groupements interarmes pour des manœuvres, respectivement dans les régions de Mediouna-Fedala, Safi, Port-Lyautey, Si-Allal-el-Tazi, Rabat.
Mais la période la plus vivante et la plus féconde - pendant laquelle les officiers révélèrent le mieux leurs aptitudes et leur personnalité, fut celle du 10 au 22 août, occupée par un grand exercice de cadres sur le terrain en région montagneuse, sous la direction du lieutenant-colonel EON et des chefs d'escadrons BEZEGHER et CAZENAVE.
C'est ainsi que furent étudiés l'organisation et le fonctionnement d'un poste de commandement de groupe mobile dans les différentes situations de défensive ou d'offensive ; les élèves rayonnant à cheval dans le Moyen-Atlas autour de deux camps de base : Dar-el-Haroussi, à 12 km au sud d'Oulmes, Ajdir et les bords de l’Aguelmane Azigza, dans la région de Kenifra.
Ils purent surtout pénétrer des difficultés énormes que présenteraient éventuellement les questions de 4e bureau (la « logistique » n'était pas encore à la mode...), en raison de la pénurie extrême dans laquelle se trouvait le Maroc avant le débarquement, dans le domaine des matériels de toute nature - et surtout automobile et transmissions malgré les fabrications et les stockages clandestins.
*
* *
Les vingt-quatre stagiaires de ce cours - dont nous n'avons pu retrouver l'arme avec exactitude, étaient le commandant FRANCK et vingt-trois capitaines, dont les noms suivent, dans l'ordre alphabétique :
BEZANGER Maurice
CANN
CARLOT
COMIOT
DE FRANCE
DELORT René-Baptiste
DE TARRAGON Bernard-Marie-Louis-Lionel
DEWATRE
GŒURY
GUIBERT
HACHETTE
JACQUOT Marcel
JAQUOT André
JAUBERT
KLEIN
LAURENT
MIRAMBEAU
MORICHERE
PIGNOLY
RAYNAUD
ROUSSEAU
SERRAZ
SICARD
Leur choix avait été dans l'ensemble fort heureux et ils rendirent les meilleurs services dans les états-majors de grandes unités, tant en Italie qu'après le débarquement en France et, plus tard, dans la campagne d'Allemagne.
Presque tous suivirent ultérieurement les cours réguliers de l'École d'état-major et de l'École supérieure de guerre. Beaucoup parvinrent à des postes élevés de la hiérarchie et deux au moins - les commandants DE TARRAGON et DELORT, sont morts au champ d'honneur.
Le Centre de formation des officiers d'état-major (CFOEM)
En juin 1943, une organisation permanente au profit de l'armée française reconstituée est créée à Rabat sous le nom de Centre de formation des officiers d’état-major (CFOEM). Il est dirigé par le colonel MORLIERE puis par le colonel SIMON.
Le CFOEM rejoint Paris dès décembre 1944 et s'installe à l'École militaire.
Il instruit sept promotions de six mois chacune jusqu’au 12 août 1946 et sa filiation est arrêtée de la manière suivante :
- 1re promotion : CVAT de 1942
- 2e promotion : 15 juillet 1943 au 15 janvier 1944 (à Rabat)
- 3e promotion : 5 janvier au 11 juillet 1944 (à Alger puis à Rabat)
- 4e promotion : 3 juillet au 15 novembre 1944
- 5e promotion : 14 décembre 1944 au 20 mai 1945
- 6e promotion : 8 mai au 16 novembre 1945 (avec des stagiaires étrangers)
- 7e promotion : 7 novembre 1945 au 12 août 1946 (reprise du cycle du temps de paix).
La conjonction de l’enseignement d’état-major dispensé dans les conditions précaires pendant la guerre et des idées personnelles du général de Lattre, chef d’état-major général de l'immédiat après-guerre et réorganisateur des forces armées, en matière de formation des cadres débouche sur une nouvelle conception de l’enseignement militaire supérieur avec la création de l'École supérieure des forces armées.
Dans celle-ci, l’École supérieure de guerre qui rouvre ses portes en novembre 1947, et le CFOEM, qui devient l'École d’état-major par décision du 13 février 1947, occupent chacun une place spécifique.
La huitième promotion du CFOEM devient ainsi la première promotion de l'École d’état-major.