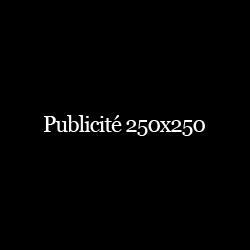Promotion 1927
La liste des admis au concours d’entrée à l’École supérieure de guerre en 1927 paraît au Journal officiel le 18 mars 1927.
La promotion compte 80 officiers : 42 viennent de l’infanterie, 6 de la cavalerie, 20 de l’artillerie, 2 du génie, 3 de l’aéronautique, 6 de l’infanterie coloniale et 1 de l’artillerie coloniale.
Les stages réglementaires d’une durée de six mois, commencent le 4 avril 1927. Ils comprennent un stage automobile, du 4 au 16 avril, à l’École d’automobile et de projecteurs, un stage de chars de combat, du 20 avril au 3 mai, dans différents régiments de chars, un stage d’aviation du 6 mai au 20 juillet dans différents régiments d’aviation, un stage d’infanterie d’une durée de quinze jours à deux mois et un stage d’artillerie d’un à trois mois, dans des régiments de ces armes, pendant des périodes de manœuvres et séjours dans les camps et enfin un stage de transmissions, du 15 au 31 octobre, à l’École de liaison et de transmissions.
Les lieutenants MAZIER et LAMBERT-DAVERDOING meurent dans une collision aérienne survenue le 19 mai 1927 pendant leur stage d’aviation. Le capitaine HEME est autorisé, pour raisons de santé, à n’entrer à l’École supérieure de guerre qu’en 1929. Le capitaine CONDAMINAS sera tué dans un accident de cheval en cours de scolarité, le 23 mai 1928.
Le 24 mai 1927, les médecins majors de deuxième classe BOUISSOU et PETIT sont désignés pour suivre les cours.
Les cours de l’École supérieure de guerre débutent le 3 novembre 1927. Vingt-neuf officiers étrangers originaires de dix-neuf pays différents vont également suivre la scolarité. Le capitaine BAUDRY, ajourné de la promotion précédente, se joindra à eux en cours de scolarité.
Les cours se terminent le 3 novembre 1929. Tous les officiers sortent brevetés à l’exception des capitaines DONATI, GASSET et GAUSSOT qui, ajournés, sont partis terminer leur scolarité dans la promotion suivante.
Quatre officiers français de cette promotion sont morts pour la France pendant la Seconde guerre mondiale : LEMONNIER, MOREL, PARIS et VAUTRIN. Parmi les officiers étrangers, BARRETT, NAIDEN et CHMIELOWSKI sont morts au champ d‘honneur pendant cette même guerre. Le maréchal DE LATTRE DE TASSIGNY est mort pour la France en 1952.
Le colonel YVON a raconté ses souvenirs de la 49e promotion dans un article paru en 1959 dans le Bulletin trimestriel de l’Association des amis de l’École supérieure de guerre.
Le chef de promotion est le chef de bataillon DE LATTRE DE TASSIGNY.
*
* *
Il y a trente ans... la 49e promotion de l’École supérieure de guerre (1927-1929)
par le colonel YVON
Article paru en 1959 dans le Bulletin trimestriel de l’Association des amis de l’École supérieure de guerre.
1 - Origine et composition de la promotion.
Cette promotion, qui avait effectué ses épreuves écrites en décembre 1926 et passé les examens oraux en mars-avril 1927, constituait, aux dires des professeurs consultés par la suite, un très honorable noyau d'officiers stagiaires d’une moyenne d’âge de 32-33 ans ayant pour plus de la moitié servi avant 1914 ou ayant fait la guerre 1914-18 ; une dizaine de lieutenants figurant l’élément jeune y représentaient la montée des jeunes générations. La liste d'admission parue au JO du 18 mars 1927 comprenait un seul officier supérieur, le chef de bataillon DE LATTRE de TASSIGNY qui venait d'accomplir un long séjour au Maroc. Les autres avaient terminé la guerre comme capitaines ou lieutenants anciens. Plus de la moitié avait fait campagne aux théâtres d’opérations extérieurs ou servi à l'étranger dans diverses missions. La promotion comptait 76 officiers français, 29 officiers étrangers, et 3 médecins stagiaires. La répartition entre les différentes armes était la suivante :
- Infanterie : 5 français dont 7 coloniaux, et 14 étrangers
- Artillerie : 10 français, dont 1 colonial, et 8 étrangers
- Cavalerie : 6 français et 4 étrangers
- Génie : 2 français et 2 étrangers
- Aéronautique : 3 français et 1 étranger (américain).
- Total : 76 français et 29 étrangers
Les trois aviateurs provenaient de l'infanterie (un) ou de la cavalerie (deux). Le commandant DE LATTRE était passé de la cavalerie dans l'infanterie pendant la guerre, ainsi que le capitaine LACROIX. Le capitaine de HESDIN (artilleur) venait de la cavalerie, ainsi que le capitaine de VILLELUME. Le capitaine MONNE, artilleur, venait de l'infanterie. Parmi les officiers français :
- 46 sortaient de l'École spéciale militaire.
- 5 sortaient de l'École polytechnique.
- 1 sortait de l'École normale supérieure (lettres).
- 1 sortait de l'École supérieure des PTT (brevet technique).
- 2 sortaient de l'École militaire d'infanterie de Saint-Maixent.
- 1 de Fontainebleau.
- 1 de Versailles.
Trois officiers étaient spécialistes de chars. De nombreux stagiaires parlaient au moins deux langues étrangères, dont quatre couramment le russe. Trois ou quatre étaient gradués en droit, ou en sciences.
Deux officiers français (LAMBERT-DAVERDOING et MAZIER) furent tués en service commandé pendant les stages d'aviation. Le capitaine CONDAMINAS fut tué, en fin de 1re année, au cours des voyages d'état-major, par accident de cheval, à Ablis. Le commandant AYALA (Paraguay) a simplement accompli la 1re année de stage.
Trois médecins étaient en outre attachés à la promotion pour en suivre les cours et aider le médecin lieutenant-colonel SCHNEIDER, médecin de l’École, à donner les soins aux élèves et à leurs familles.
Ils étaient destinés à faire les médecins détachés ultérieurement dans les 4es bureaux d'état-major d'armées.
2 - Réunion de la promotion.
La promotion fut remue pour la première foi aux Héronnières à Fontainebleau pour y accomplir un premier stage à l’École des projecteurs et de matériel automobile, puis les officiers se dispersèrent pour aller accomplir leurs stages dans les diverses unités (avril 27).
Vingt-six officiers reçurent au cours du stage d'aéronautique le brevet d'observateur en avion, démontrant ainsi que dans l'armée française de 1939 on aurait pu aussi disposer, si on les avait cherchés, de ces officiers généraux â trois dimensions si vantés dans l'armée allemande de l'époque.
La promotion entra à l'École au début d'octobre 27. Elle fut régulièrement reçue par la 48e promotion. Les deux chefs de promotion (chef d'escadron RICARD et chef de bataillon DE LATTRE) prononcèrent les discours d'usage, les officiers étrangers furent intégrés dans les divers groupes, et le travail commença immédiatement, intense, méthodique et fructueux.
Beaucoup d'officiers se connaissaient déjà, ce qui contribua dans une large mesure à instaurer l'atmosphère de saine camaraderie, jamais démentie qui caractérise l'esprit de la promotion. La personnalité du commandant DE LATTRE DE TASSIGNY comme chef de la promotion est remarquablement esquissée dans un article du général LAVAUD paru dans le Bulletin trimestriel de l’Association des Amis de l’École supérieure de guerre.
3 - Niveau d'études de la promotion
L'éloge des deux directeurs de l'École de 27-29, le général HERING et ensuite le général DUFFOUR, n'est plus à faire. Tous les deux ont marqué renseignement militaire d'entre les deux guerres d'une manière originale. Le général HERING avait profondément réfléchi aux grands problèmes tactiques et se trouvait, bien que de formation scientifique, doué d'un esprit imaginatif tout autant que raisonné ; il refusait de se laisser enfermer dans une doctrine compassée, figée, beaucoup trop rattachée aux fictions de la guerre de siège et du front continu qui nous avaient été imposées depuis la Marne jusqu'en 1918. Bien qu'artilleur, il semblait déplorer le fait de voir notre infanterie, prisonnière de la mission essentielle de couvrir un lourd système d'artillerie et ses transmissions et préconisait la décentralisation, en cas de guerre de mouvement ou de rupture du front, par l'éclatement des lourdes divisions en groupements tactiques des trois armes, pourvus de blindés.
Au moment où diverses théories s'affrontaient en haut lieu, tandis qu'il s’agissait de prendre une décision sur l'adoption ou non d'un système de guerre basé sur l'organisation préalable d'un front continu fortifié (ligne Maginot), alors que le travail préparatoire avait été effectué du temps du cabinet Painlevé, il avait pris ses responsabilités. Beau joueur, il s'était incliné mais il avait tenu à exposer lui-même la solution qui consacrait l'adoption, par le Parlement, de la théorie de la guerre défensive, c'est-à-dire du moindre effort et de la volonté d'inscrire notre « décision définitive » sur le terrain, par la construction d'ouvrages fortifiés, où l'on ferait la guerre en pantoufles, avec cinémas, foyers, etc... Cette décision eut pour résultat, comme chacun sait, de provoquer le détachement de tous nos alliés de l'Est, et de nous priver de l'armée et du matériel indispensables pour attaquer et réaliser une manœuvre offensive d’envergure au moment de l'invasion de la Pologne.
•
Mais n’avions nous pas déclaré « la paix au monde » dès l'avènement du cartel des gauches en 1924, réduit le temps de service et les périodes de réservistes, malgré les expériences cruelles mais réelles de la guerre du Rif (1925-27) et de Syrie (1926), où notre « infanterie s'était montrée très timide » et où il avait fallu désorganiser la mobilisation de l'armée française pour envoyer 100.000 hommes sur ces deux théâtres d’opérations extérieurs. Plus encore que par l'antimilitarisme, la France était pourrie par le désir de s'endormir au milieu d'un monde qui vivait plus dangereusement que jamais. La suite allait le démontrer.
Le successeur du général HERING fut le général DUFFOUR. Remarquable officier d'état-major et beau soldat : le régiment qu'il commandait pendant la guerre avait été cité deux fois à l'ordre de l'armée. Auteur d'un cours d'histoire de la Guerre 14-18, qui constitue encore maintenant le seul ouvrage vraiment maniable de l'époque, donnant des aperçus d'ensemble sur la stratégie alliée et des renseignements précieux sur la composition des diverses armées et les campagnes de la 1re Guerre mondiale. Il était assisté à la direction des études par le général LANOIX, dont un des travaux principaux était l'ajustement des programmes d'instruction des deux promotions présentes à l'École.
Les cours d'instruction générale se limitaient à quelques conférences faites par des professeurs d'université. Monsieur BARDOUX sut nous intéresser ainsi que les officiers supérieurs du Centre des hautes études militaires par une série d'entretiens sur le Congrès de Vienne. Une conférence sur les Alpes par M. BLANCHARD, professeur à l'université de Grenoble, et une autre sur l'Indochine ont marqué dans ma mémoire ainsi que celles de M. SIEGFRIED sur la Chine et les États-Unis.
Le cours de tactique générale dirigé par le colonel MEULLE-DESJARDINS, puis par le colonel Ducasse et enfin par le lieutenant-colonel ALTMAYER se ressentait des hésitations du Parlement et du gouvernement sur l'orientation à donner à notre politique et à notre stratégie. Parmi les professeurs les plus écoutés, il convient de citer le lieutenant-colonel d'artillerie JANSSEN. En deuxième année furent esquissées quelques manœuvres de corps d'armée et d'armée qui portaient la question déjà plus haut et plus loin que la tactique opérationnelle divisionnaire étudiée en 1re année. Le commandant BRUNEAU, le lieutenant-colonel ALTMAYER, le lieutenant-colonel CHADEBEC de LAVALADE ainsi que le commandant SALAUN, nous proposèrent des travaux intéressants, tenant compte d'une motorisation « envisagée ». Mais, dix ans après, on discutait encore de cette motorisation et les thèmes tactiques traités dans les états-majors indiquaient formellement que « l'on n'attaquerait pas ». C'était la seule directive que nos grands chefs avaient pu obtenir de nos politiciens de l'époque.
Ce qui nous paraissait étonnant dès 1927, c'est qu'il ne fut jamais question dans les études que l'on nous faisait faire, de lois d'organisation de notre armée, des forces morales, de nos alliances probables, des potentiels de guerre réciproques. Les conférences sur les armées étrangères déconcertaient par leur prudence. Il semblait qu'on négligeât complètement les enseignements qui auraient pu être tirés du front Est entre 1914 et 1918 ; la conférence sur l'armée soviétique par le colonel SIMON, ancien attaché militaire à Moscou, fut écoutée par un seul professeur, le colonel GIRAUD. Quant à la philosophie militaire il n'en était pas question.
Le cours d'histoire militaire organisé par le colonel GRASSET et le colonel DAILLE, était professé par le colonel LESTIEN et le lieutenant-colonel PUGENS et ne se référait qu'à la guerre 1914-18, dont il étudiait armée par armée les phases d'une bataille. En 1926-29 le cours n'avait pas dépassé les batailles de 1914. Il était intéressant, parce que très vivant et basé sur les lettres et témoignages d'officiers ayant pris part aux divers combats, choisis parfois parmi les professeurs ou les stagiaires eux-mêmes. Accessoirement, le colonel LESTIEN exposait certains problèmes d'organisation et de tactique générale du XVIIIe siècle, en une série de causeries très documentées.
Les cours d'armes se ressentaient un peu de cette attention trop uniquement fixée sur un passé récent que l'état-major de l'armée semblait vouloir tenir comme un cadre définitif.
Le cours d'artillerie était remarquablement dirigé par le colonel CHAUVIN et professé par le lieutenant-colonel DE LA PORTE DU THEIL. Malheureusement, le matériel qu'il mettait en œuvre était déjà périmé, et les plus habiles déplacements d'artillerie ne palliaient pas sa portée insuffisante ou sa vulnérabilité sous des bombes d'avion.
Le cours d'infanterie avait mis le combat du fantassin en formules telles que « le char est une voiture qui livre du feu à domicile », et faisait de la base et du plan de feux une panacée universelle. Le lieutenant-colonel GIRAUD, venu du Maroc avec une nouvelle équipe, les commandants de MONSABERT, Henri MARTIN, DODY, s'efforçait de nous sortir de l'emprise du front continu et de la guerre de siège.
Le cours de cavalerie, dirigé par le colonel DE LA LAURENCIE, nous apparaissait comme très timide. Le fait d'avoir posé le problème du mouvement d'une division de cavalerie à cheval dans un cas, motorisée dans un autre, d'Estrées-Saint-Denis vers le nord d'Arras et de ne pas avoir osé trancher en faveur soit de l'un, soit de l'autre des deux modes de transport, sur le plan de la rapidité, avait comblé la promotion d'étonnement.
Le cours du génie, dirigé par le colonel CHAUVINEAU (un des auteurs du projet Painlevé de la ligne dite Maginot), tendait à nous démontrer l'excellence des lignes fortifiées du moment, successives et coulées dans le béton, en moins de trois à cinq jours. Le cours était bien fait, et bien qu'orienté entièrement vers la défensive faisait ressortir l'importance prise par l'arme du génie. La visite des ouvrages de Verdun et de Metz en fin de 1re année fut remarquablement conduite par le lieutenant-colonel SAINTAGNE et les enseignements retirés en furent précieux pour les reconnaissances que nous eûmes à effectuer sur divers points de la frontière à fortifier. En réalité, le cours justifiait la théorie du moindre effort : Vaincre sans attaquer, qui était celle des gouvernements de l'époque.
Le cours d'aéronautique, dirigé par le colonel HOUDEMON, était un des plus intéressants, tout au moins dans ses applications tactiques et dans les travaux proposés, où l'on voyait déjà plus haut et plus loin que les taupinières de Berry-au-Bac ou des Éparges. Deux de nos camarades, ROMATET et BERGERET nous firent les conférences sur la « chasse » et le « bombardement » où ils avaient brillé pendant la guerre 14-18. Manifestement, les aviateurs cherchaient leur voie et la trouvaient, plus vite que les blindés, ayant plus de liberté dans leur organisation nouvelle indépendante que les chars sur qui pesait la suspicion du qualificatif « d'arme offensive » et qu'on avait intégré dans une organisation ancienne ce qui ne déplaisait d'ailleurs pas à une opinion « défensive » avant tout.
J'allais oublier les cours de langues. En anglais et en allemand, des officiers plus ou moins spécialistes s'efforçaient d'inculquer aux officiers stagiaires la langue « militaire » comme le désirait l’état-major de l’armée. Or, il n’existe dans aucune langue, de langue militaire proprement dite. Hors un vocabulaire spécial, qu’un étudiant connaissant bien la langue, sa philosophie et sa syntaxe s’assimile en quelques leçons. On l’avait compris à l’École supérieure de guerre pour le russe où un professeur de l’École des Langues orientales, M. BEAULIEU, venait deux fois par semaine et donnait des leçons de russe normal et non pas de russe militaire. Il n’y avait pas de cours d’arabe, et pourtant plus de la moitié de l’infanterie française était composée de Nord-Africains.
Les conférences sur les services furent faites par le médecin lieutenant-colonel SCHNEIDER, médecin de l’École, et l’intendant militaire CHAUMONT, directeur de l’École de l’intendance, dont les élèves prenaient part avec nous aux exercices de 4e bureau sur la carte, en tant qu’auditeurs libres, ainsi que les trois médecins stagiaires. Elles étaient correctes. La logistique n’avait pas encore pris la place qui fut la sienne durant la 2de Guerre mondiale.
Parmi les questions qui relèvent maintenant plis de l’École d’état-major que de l’École supérieure de guerre, qu’il me soit permis de citer celles qui nous paraissaient les plus intéressantes et n’avaient pourtant pas toujours reçu une solution nécessaire :
En 1914, 50% des officiers ne savaient pas téléphoner. Dans notre promotion 50 à 55% des officiers ne savaient pas conduire en arrivant à Fontainebleau. Les stages les mirent en mesure de passer leur brevet de conduite. Les cours de conduite continuèrent à l’École, ainsi que le cours de réparation.
Une idée du général MAURIN, et de notre camarade REVERS, eut facilité bien des choses, si elle avait été mise en pratique. L’inspecteur général de l'artillerie préconisait, dès 1926, que par analogie avec ce qui se passait avant la guerre de 14, lors de la remonte des officiers, chaque officier reçut sa voiture, moyennant un premier versement assez faible. L'État avançait le reste, moyennant quoi la voiture restait sa propriété jusqu'au remboursement par l'officier des 2/3 de sa valeur. Dès lors elle devenait propriété de l'officier. Celui-ci aurait dû accepter le modèle imposé, tenir la voiture prête à toute réquisition, payer l'entretien et les assurances. L'idée ne semble pas avoir perdu toute valeur en 1959.
Il existait une salle, où une trentaine de vieilles machines tendaient leurs touches aux officiers qui, aux heures perdues, venaient s'exercer à la dactylographie. Tout officier et surtout tout officier d'état-major devrait savoir taper sous la dictée et rédiger à la machine. Il nous aurait paru normal que, dès son admission à l'École de guerre, tout officier eut reçu une machine à écrire portative du dernier modèle.
Il n'existait pas de cours de télécommunications et de chiffrement. C’était une lacune considérable dans l'instruction. J'ai rendu compte par ailleurs de mes difficultés dans mon poste d'Extrême-Orient, en 1940-45, lorsque je fus muni clandestinement de codes, non déposés à la commission d'armistice. Ces codes n'étaient employables que par fil. Or, depuis 1936 les communications avec la Chine ne se faisaient plus que par TSF. Les marins savaient chiffrer. Les agents des Affaires étrangères, y compris les ambassadeurs, disposant d'ailleurs de tables de chiffres très commodes, savaient chiffrer. Les problèmes sont les mêmes pour les écoutes radiophoniques. Nous n'étions pas munis de postes de TSF et trop peu familiarisés avec les transmissions.
4 - Les stages d'armes. Enseignements.
Les stages d'armes furent accomplis, soit avant l'entrée à l'École, soit entre la 1re et la 2e année.
a) Stage au 503e régiment de chars de combat
Aussitôt après la 1re réunion de l'École pour le stage automobile à l'École des projecteurs de Fontainebleau, au cours duquel il nous fut donné de visiter le musée d'artillerie très complet et d'en recevoir le catalogue qui simplifiait heureusement la masse de règlements sur les divers matériels d'artillerie sur lesquels nous avions risqué d'être interrogés à l'oral (122 je crois) , nous fûmes envoyés, groupés, au 503e régiment de chars de combat à Satory. La proximité de l'École des chars à Versailles nous permit de recevoir des enseignements assez complets sur le matériel et les théories d'emploi de l'arme blindée, uniquement composée des petits chars Renault, avec lesquels nous avions terminé la guerre. La doctrine était définitivement fixée, les chars étaient rattachés à l'infanterie dont ils constituaient une subdivision d'arme spéciale et ne devaient être employés qu'en liaison intime avec elle.
Nous apprîmes à conduire un char dans les fondrières de Satory, et le stage d’un mois effectué dans un régiment squelettique ne nous apporta rien de bien nouveau.
b) Stages dans l'aéronautique.
Lee stages dans les régiments d'aviation commençaient le 9 mai 1927. Le but du stage était double :
Donner aux officiers reçus à l'École de Guerre un aperçu sur la vie intérieure de l'Aéronautique et ses possibilités en temps de guerre (stage d'information).
Donner aux officiers reconnus aptes, l'instruction d'observateurs.
Nous fûmes à cet effet répartis entre les régiments d'aviation de l'armée du Rhin, à la 3e et la 4e brigade mixte aérienne, à la 1re et à la 2e division aérienne.
Le 34e régiment d'aviation (Le Bourget) reçut aussi un bon nombre d'entre nous et après le stage d'information, tandis que certains de nos camarades rejoignaient les régiments d'infanterie ou de cavalerie, nous commençâmes au début de juin notre entraînement en vue d'obtenir le brevet d'observateur. Le travail était neuf et intéressant : c'était vraiment quelque chose de nouveau, bien que les moyens restassent encore très faibles et que les cadres soient loin d’être formés comme instructeurs, mais le matériel de l'arme nouvelle commençait à sortir (Breguet 19 au lieu du Breguet 14). J'avais choisi Le Bourget. Je n'eus pas à le regretter. Malgré la charge que nous représentions pour le régiment, divisé en un groupe de chasse (commandants WEISS et PINSARD), un groupe de grande reconnaissance, un d'observation de bombardement (commandant GAMA et commandant LAURENT), l'instruction y était bien donnée et le matériel à peu près entretenu. Le temps « moyen » qui régna sur l'Ile-de-France cet été là, nous permit de nous rendre compte qu'on ne volait pas toujours quand on voulait (à l’époque) et que les servitudes du matériel avaient aussi leur mot à dire.
Nous eûmes la joie d'assister à la réception de l'aviateur Lindberg, venu de New-York au Bourget sans escale, et qui atterrit le samedi 21 mai 1927 alors que personne ne l'attendait plus. De même, nous eûmes la visite, le 29 juin, du ministre de l'Air italien M. BALBO, à bord de son Fiat 22/370. Nous pûmes constater la légèreté et l'élégance de son parachute, beaucoup plus maniable que les énormes et très incommodes parachutes dont nous étions dotés.
Pendant notre stage, COSTE et BELLONTE prirent leur envol du Bourget pour leur raid vers la Sibérie.
Je sors les détails qui suivent, de mon carnet de stage :
« L'instruction des cadres de l'Aéronautique est une chose très délicate et qui exige de gros efforts, même de la part d'officiers entraînés au travail intellectuel et confirmés dans leur métier. Le programme est vaste. II est loin d'être atteint, faute de temps et parce que les officiers de l'Aéronautique ne sont pas assez nombreux et pas suffisamment déchargés des soucis que leur cause l'entretien de leur matériel... Pour être un bon aviateur, il ne suffit pas de remporter des challenges, c'est un côté de la question. Il faut être certes confirmé dans le métier d'aviateur, mais avoir l'esprit curieux, sans cesse en éveil et se tenir parfaitement au courant de ce qui se fait dans les autres armes, voire dans les autres armées, posséder des connaissances générales étendues et certaines qualités d'à-propos, permettant d'envisager le corps des officiers aviateurs comme une copie du corps des officiers de marine, qui a fait ses preuves en France comme à l'étranger.
L'aviation est une arme d'avenir. Son recrutement doit dès maintenant tenir compte de certaines considérations pour assurer les cadres futurs. »
En 1927, nous étions loin de compte, car si les commandants d'escadrilles avaient été d'excellents pilotes, en fin de guerre, on ne trouvait guère dans les régiments d'aviation, à part les officiers supérieurs, que de rares officiers pourvus de cette instruction générale tant réclamée. Dix ans plus tard, on commençait à les voir apparaître comme capitaines, chefs d'escadrilles et commandants de groupes, mais il a fallu longtemps à l'aéronautique pour posséder un corps normal d'officiers.
c) Stage d'artillerie.
Le stage d'aviation se termina pour les 26 officiers brevetés observateurs en juillet 1927. Immédiatement après, les stagiaires furent répartis dans les divers régiments partant aux manœuvres ou dans les camps.
Avec EYRAUD, FRANCHET d'ESPEREY et RUDLOFF, j'avais été affecté au 310e régiment d'artillerie coloniale portée à Rueil, pour partir au camp de Châlons. Le 310e RACP était un régiment appartenant à la réserve générale. Il était composé de trois groupes de 75 porté, d'un type spécial, chacun des tracteurs porte-canon, ainsi d'ailleurs que tous les autres véhicules, fonctionnait au charbon de bois, à l'aide d'un gazogène. Le régiment était entièrement composé de coloniaux dont environ la moitié du contingent, sous les ordres du lieutenant-colonel ALBISSER et de cadres confirmés. Je ne sais quels furent les résultats de cette expérience, mais durant les deux mois de séjour je n'eus qu'à me louer de ce stage, nous faisant découvrir les perspectives oh ! Combien lointaines de la motorisation. Je regrette que mon carnet de stage ne m'ait jamais été retourné. Il devait contenir quelques notes intéressantes. Nous quittâmes Rueil trois jours après notre affectation à destination du camp de Châlons, trois étapes par les villages du Parisis, Mitry-Mory, la forêt de Villers-Cotterêts et Reims nous amenèrent sans dégâts à Châlons, où nous fûmes logés dans les petits pavillons construits pour les officiers de la suite du Tsar en 1898, et l'instruction technique et tactique du régiment avec, je crois bien, la garnison de Paris, en tout cas avec le 6e régiment hippo de Vincennes se poursuivit régulièrement. Nous fûmes inspectés par le général GOURAUD et présentés par le colonel ALBISSER à cette éminente figure militaire, qui découvrant en ma personne un capitaine, futur breveté, portant les écussons du 2e étranger où je venais de faire la campagne du Rif, ne put s'empêcher de déclarer, an tant que vieil africain, que « si les officiers de la Légion étrangère se présentaient à l’École supérieure de guerre c'était la fin de cet honorable Corps ». Plus tard, six ans plus tard, placé directement sous ses ordres à la Région de Paris, je lui rappelai cette boutade. Il me répondit avec ce sourire indéfinissable qui le caractérisait « Maintenant que vous êtes marsouin, tout est effacé ».
Le stage fut des plus fructueux. Outre la révision et l'apprentissage de tous ces matériels, tout de même oh ! bien timidement, nouveaux nous pûmes faire deux ou trois ascensions en ballon captif et enfin procéder aux tirs réglementaires à la tête de nos batteries respectives. Ce fut plus qu'honorable ; le commandant de groupe nous dit bien qu'une salve longue et une salve courte, aussitôt transformée en salve au but « ce n'était pas de l'artillerie », nous fûmes piqués au jeu et nous lui demandâmes quelques projectiles pour essayer un réglage par la méthode du réticule tangent que nous avions étudiée durant toute une soirée. Là encore ce fut très honorable.
Le Colonel exultait car un ou deux de ses capitaines avaient été étonnés de se voir demander ce genre de tir.
Nous fûmes reçus, ainsi que tous les officiers d'artillerie de la division, sous la tente du général ATGER, commandant l'artillerie de la Division, homme aimable par excellence avec lequel j'avais eu maille à partir à Saint-Cyr, un soir où il était capitaine de garde et où le vent ne soufflait pas du grand carré. Je le lui rappelai également ainsi que les quinze jours d'arrêt de rigueur qui avaient suivi. Il en fut enchanté et nous entonnâmes un « artilleur de Metz solennel », coupe de champagne en mains.
d) Stage de cavalerie.
Pour tous ceux qui avaient employé la plus grande partie de l'été 27 à passer leur brevet d'observateur en avion, le stage de cavalerie - un mois – avait dû être reporté à l'intervalle entre la 1re et 2e année, après le voyage de frontières. J’avais été désigné pour le 1er Dragons (Moulins) que je dus rejoindre vers 1er septembre 1928 au camp de la Courtine, en même temps que le chef d'escadron LEMONNIER et un autre camarade que ma mémoire défaillante m'empêche de situer. Là aussi mon carnet de stage ne me fut jamais retourné. Je rejoignis par Brive et Tulle, dans un pays admirable absolument inconnu de moi, fort pittoresque, mais copieusement arrosé en cet automne 1928.
Nous fûmes reçus magnifiquement par le colonel de MAISONNEUVE et ses officiers au mess de la garnison, où le régiment était seul. Le camp était confortablement aménagé, comme l'avait été celui de Coëtquidan pendant la guerre 14-18 par les Américains, auxquels nous devons beaucoup en cette matière.
Le soir même de notre arrivée, le colonel nous demanda de le représenter à une soirée offerte par la comtesse Germaine des ESCURADIS, château situé au milieu du camp. Des chevaux sellés nous attendraient vers 8h30 après dîner, ce qui nous mettrait vers 9h30 à destination. Nous acquiesçâmes par politesse, mais lorsque j’eûs pris contact avec le lieutenant qui devait nous servir de guide et qui était officier de réserve, arrivé depuis la veille, je flairai le « canular » classique. Rien que le nom des Escuradis m’était déjà suspect, et surtout la phrase de mon vieil ami DE FAURE « Attention aux polards ». Je fus vite convaincu. Sous une pluie battante, nous revêtîmes nos imperméables et nous nous mîmes en selle à l’heure dite, sous l’œil goguenard des cavaliers. Le lendemain, personne ne souffla mot ; je crois que seul Lemonnier regretta de ne pas avoir poussé jusqu’aux Escuradis « lieudit » effectivement marqué sur la carte et qui n’est qu’un « polard » comme les autres et que nous eûmes l’occasion de reconnaître plusieurs fois par la suite au cours des manœuvres à pied ou à cheval du régiment.
La cavalerie à cheval était en train de mourir de sa belle mort et c'était dommage, car elle avait su encore en 1926 écrire de belles pages au Levant.
En tout cas elle conservait ses, belles traditions d'honneur et de combativité qui avaient déjà passé avec ses meilleurs cadres dans l'aviation et qui se perpétue dans les blindés.
C'est au camp de la Courtine que je fis plus amplement connaissance avec LEMONNIER. Non seulement il travaillait comme nous dans la journée avec son escadron, mais le soir, à la lueur d'une bougie, il se perfectionnait dans sa chambre en allemand et en anglais. Nous nous étions liés d'affection et son expérience d'Indochine et d'ailleurs ne fut pas sans influer sur mes destinées. Il poussa la conscience professionnelle jusqu'à demander à faire à ses frais les étapes de retour avec le régiment jusqu'à Moulins, pour mieux connaitre la manière dont se déplaçait sur route un régiment de cavalerie.
5 - Rythme général du travail.
Des quelques considérations qui précèdent, il ne faudrait pas déduire que l’enseignement donné à l'École était mauvais ou mal adapté. Professeurs et instructeurs, et il n'y avait pas d'insuffisances, s'ingéniaient à le rendre intéressant et à rechercher dans leur propre expérience et les évènements les plus récents, les éléments d'une doctrine. Où et comment s'élaborait cette doctrine? Cela, nous ne l'avons jamais su et les professeurs interrogés par la suite m'ont toujours déclaré qu'ils n'en savaient rien, eux non plus. Tout ce que l'on peut dire c'est qu'il y avait une méthodologie unique pour traiter les divers problèmes (Mission, Ennemi, Terrain, Moyens, Décision), une certaine uniformité de langue et de présentation et pas trop de contradictions apparente entre les différents cours. D'ailleurs, l'École de Guerre n'a jamais été, à ma connaissance, chargée d’établir la doctrine, sans cela la ligne dite Maginot n'aurait jamais été construite, du moins telle qu'elle le fut, car nos instructeurs et nous-mêmes sentions ce qui nous manquait : Précisément, cette doctrine et surtout un chef pour coordonner les diverses tendances et décider en dernier ressort. Quoiqu'il en soit, le rythme du travail réparti entre les amphis, les cours, les travaux en salle ou sur le terrain, les voyages, ne laissait aucun répit. Les séances d'équitation avaient lieu le matin à 7 heures d'abord au manège, puis à l’extérieur, c’est-à-dire au Bois de Boulogne, à partir du printemps ; les cours de langue suivaient de 9 heures à 10h15, puis l'amphi principal de la journée de 10h30 à midi (cours ou conférence). L'après-midi, à partir de 14 heures, avaient lieu les exercices sur la carte dans les baraques en bois (appelées le PC des Alliés), primitives, mal commodes et mal chauffées, installées dans les cours de l'École, là où ont été construits maintenant des mess confortables ou des salles d'amphis. A ces exercices assistaient, à titre d'auditeurs libres, les élèves de l'École de l’intendance qui reprenaient chez eux sur le même thème, ainsi que les médecins, les questions de 4e bureau. Au moins deux fois par mois ces exercices étaient complétés par des exercices sur le terrain, généralement au nord-est de Paris, où nous emmenaient des autobus de la RATP. Tout cela durait jusqu'à 18 heures. A peine disposions-nous de un ou deux après-midi par semaine pour exécuter chez nous les redoutables et minutieux travaux à domicile, ou étudier les thèmes tactiques proposés. Il restait les soirées et elles étaient toutes employées souvent jusqu’à 2 et 3 heures du matin. Les épouses de ceux d'entre nous qui s'étaient imaginées que les deux années de Paris devaient leur permettre de profiter des spectacles et sorties diverses de la capitale furent amèrement déçues. Elles assistèrent à des travaux de forçats et même y prirent part, non seulement assemblant et collant les cartes mais aussi les renseignant aux crayons de couleur et la tradition s’en est certainement continuée. Pauvres épouses de brevetés ; elles méritent qu'on leur rende justice, car souvent la situation matérielle n'était pas brillante et leurs soucis de maitresse de maison étaient immenses. Il restait peu de temps pour discuter entre nous ou pour se réunir. Tout au plus avaient lieu de temps à autre des colloques à 3 ou 4, au Tourville, ou à la Bière Brune pour préciser un point de détail ou aider un camarade en difficulté. Certains travaillaient par groupes, le chef de groupe imposant sa solution et exigeant la collaboration de tous les camarades du groupe. C'était à l'époque, une forme assez peu prisée de la direction de l'École. Dans l'ensemble, les travaux étaient exécutés individuellement ; un camarade avait l'habitude de préparer deux travaux et remettait celui dont la solution, après les consultations du dernier moment, semblait réunir la majorité. Les travaux étaient rendus après une correction très soignée et servaient, avec les notes d'interrogation au cours des exercices tactiques à établir le classement. Tout était noté, la tenue, l’assiduité, mais il était tout de même permis d'être malade, et il est bien certain que ces deux années, que personne ne regrette, représentaient un effort considérable ne fut-ce qu'au point de vue physique. « Travail d'enfer », disait le prince AAGE de Danemark, de la 48e promotion. « Je ne connais que deux catégories de gens qui travaillent à Paris en ce moment : les officiers de l’École de guerre et les internes des hôpitaux » disait M. Paul BOYER, administrateur de l'École des Langues orientales vivantes. A une époque où tout le monde se réjouissait au son des rengaines « Amusons-nous comme des fous » ou « Tout va très bien. Madame la Marquise », cet entraînement au travail était plus que méritoire. Ce malaxage, qui excluait toute précipitation et n'admettait aucun répit, aucun retard, mais soulignait les erreurs de méthode, les mauvais dosages, les fâcheuses digressions, avait au moins pour résultat de confirmer les stagiaires dans les diverses études qui leur furent soumises, de leur donner confiance, de leur apprendre à réfléchir, à constituer et à utiliser une documentation sur les questions les plus différentes, en tirer les arguments nécessaires pour aboutir à une conclusion logique et exploitable immédiatement. Pour ma part, je suis infiniment reconnaissant à l'École de m'avoir laissé mon indépendance de pensée, tout en me permettant au cours des divers métiers que j’ai exercé depuis, de traiter méthodiquement les questions qui m'ont été soumises, comme chef des services économiques à Berlin en particulier.
Deux fois par an nous fûmes reçus par les chefs de cours qui nous firent part de nos faiblesses ou de nos « bons points » et encouragés dans le sens des nouveaux efforts à fournir.
A la fin de chaque année, ce fut le tour du Général, qui nous confirma les appréciations de nos professeurs et nous mit au courant des résultats de nos travaux. Le général HERING aurait voulu que l'on supprimât le classement qui, disait-il, faussait tout. Il est certain que la perspective du légendaire classement en trois tiers agissait plutôt comme facteur négatif, en ce qui concerne la recherche de la personnalité chez le stagiaire.
La légende voulait aussi que les futurs commandants de corps d'armée fussent choisis dès la fin de la 1re année. Mais recherchait-on tant que cela les personnalités ? Grammatici certant ...
6 - Installation matérielle.
a) Traitements et indemnités.
Les préoccupations matérielles n'étaient pas exclues du train normal de la vie quotidienne tout au moins pour les stagiaires mariés.
Les traitements étaient ce qu'ils sont toujours, c'est-à-dire médiocres. Les indemnités, dites de Paris, étaient nettement insuffisantes pour faire vivre décemment un ménage de professeur ou de stagiaire. Le commandement avait bien essayé de faire attribuer une indemnité dite technique ; aussitôt les intendants, les contrôleurs avaient réclamé la même faveur et l'insuccès avait été complet. On a prétendu que l'indemnité de 100 NF par an, versée aux brevetés observateurs en avion avait été instituée pour combler en partie le déficit dans les budgets. C'était une méchanceté toute gratuite qui mettait en position d'humiliation un certain nombre de ceux qui avaient été volontaires pour passer le brevet. On a parlé à l'époque dans la presse de stagiaires obligés de laver des voitures la nuit pour faire vivre leur famille. Hier encore (Paris-Presse du 30 avril 1959) a ressorti le même cliché. La chose est possible : rien n'en a jamais transpiré.
Bien entendu il n'était pas question, à l'époque, de sécurité sociale ni d'allocations familiales. Il y avait un mess qui fonctionnait à l'École militaire pour les officiers de la garnison. Il portait le nom de « Haricot populaire » et était impraticable. Le Cercle de la place Saint-Augustin n'était pas encore construit, et il n'était pas question d'aller à l'ancien Cercle de l'avenue de l'Opéra. Nous prenions nos repas chez GANGLOFF ou les gargotes qui entourent l'École militaire. C'était un premier déclassement.
b) Logement.
Ce qui était plus grave, c'était la question logement qui déjà se faisait cruellement sentir. En 1905, un officier, guerre ou marine, reçu à l'École de Guerre choisissait son quartier, généralement les nouvelles avenues rayonnant autour des Invalides, ou dans le VIe et VIIe. Dès 1925, ce n'était plus possible, par suite de la crise des logements et du prix des loyers noirs. Il avait fallu se rabattre sur le XIVe et le XVe, en particulier la Porte de Versailles, l'avenue Émile-Zola, la rue de la Convention ou la périphérie, Versailles ou la banlieue, Clichy, Levallois, Boulogne, Vincennes. Pour les ménages les plus fortunés, les nouvelles constructions de l'avenue de La Bourdonnais ou du Champ de Mars offraient quelques possibilités. Les officiers étrangers disposaient en général de frais suffisants de mission pour se loger pas très loin de l'École ou racheter les mobiliers moyennant le paiement de tarifs scandaleux de reprises. Certains célibataires vivaient dans des pensions de famille ou en phalanstères, comme les Grecs.
Il y a eu là une grande carence du gouvernement et du commandement de l’époque, d'avoir laissé vendre par les Domaines les terrains des anciennes casernes et des anciens manèges de l’École militaire ou d’y avoir laissé construire des immenses bâtisses du ministère du Travail, ou de l’UNESCO, plutôt que d’y installer un quartier d’habitations militaires.
c) Dépenses diverses. Réceptions.
La tenue devait être non seulement correcte, mais impeccable. Elle était exigée pour toutes les séances prévues au programme de l'École. Il n'y eut lamais de dérogations à cette règle et la tradition ne semble pas avoir été perdue. Mais c'était une source de dépenses hélas non négligeables et les changements d'armes étaient pénibles pour les budgets. Il est anormal de constater que le commandement n'avait pas été capable de constituer une sorte de coopérative militaire, genre Army and Navy, susceptible de fournir aux officiers des uniformes convenables, bien coupés et en bonne étoffe, des chaussures et des bottes de modèle courant et les fournitures indispensables (tentes, matériel de rampement, conserves, denrées, etc...). Toutes les tentatives faites en ce sens avaient échoué, même à l'armée du Rhin par suite, disait-on, de la mauvaise volonté des intendants et des interventions parlementaires en faveur des tailleurs et bottiers. Aussi la hausse du prix de la vie ressentie dans les budgets d'officiers, surtout à partir de 1924, ne correspondait plus aux traitements et indemnités et la suppression de l'ordonnance n'était pas couverte par l'indemnité dite de femme de ménage.
Un séjour à Paris de deux ans et demi correspondait à un prélèvement net sur les ressources de l'officier de 30.000 à 40.000 francs de l'époque, soit 1 million, 1,5 million de 1959. Bien des candidats à l'École de Guerre durent renoncer devant ces perspectives. De nombreux officiers de valeur, sollicités de venir y professer des cours, durent refuser leur affectation à Paris, faute de moyens suffisants. Mais il n'était pas de bon ton à l'époque d'agiter ces questions.
Dans ces conditions, il ne pouvait s'agir d'organiser des dîners ou des réceptions entre nous. Quelques cocktails et ce fut tout.
Le général HERING nous reçut chez lui ainsi que Mme HERING, dans sa villa de Neuilly et le général DUFFOUR un jour à l'École dans un salon du 1er étage. Contrairement à ce qui se passait en 1905, où les officiers de marine en stage à l'École de guerre navale étaient reçus avec leurs femmes aux réceptions de l'Élysée nous ne fûmes jamais invités, pas plus d'ailleurs que nos professeurs.
7 - Voyages d'armes et de frontières.
a) Voyages d'armes.
Le régime de l'École était très libéral. A partir du printemps, les dates de remise des travaux étant fixées, l'emploi du temps nous donnait rendez-vous un certain jour à la mairie ou à la gare de X... à 14 heures pour prendre part à un voyage d'arme, ou à un tir d'ensemble d'une artillerie divisionnaire renforcée (séjour au camp d’Haguenau par exemple). Dans l'intervalle, les stagiaires étaient libres d'organiser leur emploi du temps comme ils l'entendaient.
Les voyages de frontières, couronnement de la 1re et de la 2e année, organisés sur ces principes, furent des plus intéressants.
b) Voyage du Nord-Est (été 1928).
Nous avions rendez-vous à Dunkerque le 10 juillet, et nous y passâmes la journée et la matinée des 10 et 11, à la visite du port reconstruit et du système de défense.
Les 11, 12 et 13, visite de la région de Calais - Saint-Orner, de Lille et de Roubaix où nous visitâmes le peignage Mothe et fûmes reçus au Cercle de l'Industrie. Le général HER1NG avait tenu à nous mettre en contact avec les principaux chefs d'industrie du Nord, très inquiets de voir que les nouveaux projets d'organisation de la frontière, semblaient une fois de plus négliger la région industrielle du Nord.
Le 14 juillet c’était Maubeuge, dont la capitulation précipitée en 1914 reste toujours un mystère et je consacrais le 15 à la reconnaissance de Namur et de la vallée de la Meuse.
Le 16 juillet, la promotion était regroupée à Neufchâteau et visitait en autocar les champs de bataille de l'Ardenne et en particulier de Rossignol, cimetière du 1er corps d’armée colonial, avec le commandant LARCHER comme conférencier. Ces tombes, dans le silence de la forêt, bien alignées, où figuraient les noms de nombre de nos anciens, nous remplirent d'un émoi profond.
Les 17 et 18 juillet, nous visitâmes Thionville et la région de Teterchen-Boulay, Le 18 juillet, nous étions regroupés à Metz, ville française.
Le 19 juillet et le 20 juillet, visite en groupe de Verdun, admirablement bien conduite, où il nous fut donné de toucher certaines données précises sur la fortification. La comparaison avec les fortifications de Metz, bien que plus modernes, n'était pas toujours en faveur du génie allemand. Les Allemands ont dépensé, pour la fortification de Metz, 245 millions de francs ; les Français qui avaient dépensé, de 1875 à 1885, 700 millions pour l'organisation Séré de Rivière (y compris les forts de Reims et le camp retranché de Paris), avaient engagé à Verdun 170 millions (tout compris) (même pas le prix d'une journée de guerre). Nous restâmes jusqu'au 24 juillet dans la région de Metz, après visite des champs de bataille de 1870. Le soir du 24, le bataillon de Saint-Cyr, casoars au vent et drapeau en tête, défilait dans Metz. En 1914, nous autres Saint-Cyriens avions dû nous arrêter à Mars-la-Tour. Nous visitâmes encore les mines de la vallée de l'Orne et les aciéries de Rombas, avec un déjeuner au Cercle des ingénieurs de Hagondange (De Wendel).
Cette visite de la frontière du Nord fut à mon avis trop rapide. Si la visite détaillée de Metz et de Verdun peut se faire en 4 ou 5 jours, la région du Nord et la vallée de la Meuse n'était pas suffisamment étudiée. Chacun d'entre note avait eu à étudier et à remettre un travail de reconnaissance bien déterminé, dans le cadre des projets établis pour la ligne Maginot. J'avais eu ainsi à i reconnaître les hauteurs de Teterchen, Hargarten et de la Petite-Rosselle, puis la région Boulay-Saint-Avold.
Le 25 juillet, commença le voyage dans les Pays Rhénans.
La reconnaissance de l'Eifel par Wettlich, Daün, Nürnbourg-Ring, Adenau. Maria Lach-Andernach - Coblence faite en groupe par autocars n'était pas pour beaucoup d'entre nous une nouveauté. Le Nürnbourg-Ring avec ses 50 km de développement construit en notre présence et casse-tête des états-majors de Coblence et de Mayence entre 1922 et 1927, se révéla en 1939 être une vaste plaque tournante pour 2 ou 3 divisions motorisées ou blindées de Wehrmacht pouvant déboucher en moins de 12 heures soit sur la frontière belge, soit sur la frontière française, soit dans la Sarre.
Du 26 au 28 juillet, nous parcourions la vallée du Rhin et la tête de pont de Mayence. Pour un bon tiers d'entre nous, qui avions tenu garnison à Mayence la découverte du Rhin ne se posait plus. Par contre, je fus frappé sur le trajet de Mayence à Kaiserslautern par Alzey, de l'aménagement très sensible des gares et des lignes à une voie déployées près de notre nouvelle frontière. Lorsque j'étais capitaine à la commission de réseau de Mayence en dehors des cinq ou six grandes magistrales capitales du Palatinat que nous avions maintenues ou fait remettre à une voie, toute cette région du Mont-Tonnerre était très dépourvue de voies ferrées. Je fis part de mes observations à un camarade de l’état-major de Kaiserslautern, qui ne semblait guère s'en soucier, pas plus que des compagnies entières de motocyclistes qui rentraient en pétaradant le dimanche soir, ou des armées de touristes avec sacs et paquetage, auxquels il ne manquait que le fusil, qui parcouraient toute la région. Mais déjà et visiblement nous avions abandonné la partie. J'avais quitté en 1922 l'armée du Rhin, encore en plein élan guerrier de la victoire. Six ans après, tout était déjà changé. On ne passe pas deux fois par le même chemin... et pourtant si, puisque nous y sommes encore, mais dans d'autres conditions.
Cotte frontière qui n'était déjà pas celle de 1814, mais celle de 1815, et qui avait fait l'objet de toutes nos rêveries de jeunesse, pour la reconquête de laquelle nous étions entrés dans l'armée, que nous avions arrosée de notre sang et que nous venions de visiter en vainqueurs, restait tout de même une « frontière de vaincus ». Évidemment il y avait la position formidable de Metz et de Thionville qui couvrait bien le fer malencontreusement placé trop près des convoitises allemandes, mais laissait le charbon en-dehors. Toutes les voies ferrées étaient encore dirigées contre nous et encore mal soudées à notre réseau général.
Si solide que devait être notre future cuirasse, il restait bien des trouées, bien des obstacles. La forge d'Alberich continuait à mugir dans le prochain lointain, et si la randonnée des « vierges guerrières » avait cessé, pour un temps, de chevaucher les hauts lieux proches, les « filles du Rhin » continuaient à pleurer l’or perdu, et les Nornes à tisser les filets des destins franco-germaniques. Car le fleuve des légendes était là, tout près, continuant à couler au fond de son couloir. On sentait son approche dès Longwy et la Meuse et le vent qui soufflait par Calais, Gand, Namur, Luxembourg, la Sarre et Strasbourg n'était pas le même que celui qui pouvait souffler à Bourges, à Tours ou Orléans, en « doulce » France, peut-être un peu trop « doulce » et un peu trop endormie au bout de la péninsule européenne.
Strasbourg et les Vosges devaient être la dernière partie du voyage.
Le 29 juillet, nous effectuions la reconnaissance de la frontière entre Sarreguemines et la frontière de Basse-Alsace, par Bitche et Haguenau et le soir nous étions à Strasbourg.
Le lendemain, la promotion regroupée visitait la position de Molsheim, Mutzig, puis Sainte-Odile.
La visite du port de Strasbourg, le 31 juillet, construit sous la domination allemande, malgré les Allemands, et achevé par les Français, eut pour résultat de nous donner quelques chiffres et de nous démontrer l'utilité de notre présence sur le Rhin. Tel qu'il était en 1928 c'était déjà un puissant instrument de travail, dont l'importance depuis n'a fait que croître malgré la concurrence du port de Kehl. A vrai dire le port de Strasbourg n'atteindra son plein développement que lorsqu'il sera mieux relié par canaux avec l'Est et surtout la grande voie Saône-Rhône.
Le voyage des Vosges du 1er au 2 août aurait dû englober Belfort, Roppe, la région du Lomont et même Besançon, car il y a là matière à réflexions, mais aucun regroupement n'était prévu après Colmar, et les crédits commençaient à s’épuiser.
b) Exercice combiné (été 29).
Au début de l'été 1929, nous fûmes appelés à prendre part à un exercice sur la carte avec nos camarades de l'École de guerre navale. D'abord travail en salle à Paris pour la mise au point, puis exercice sur le terrain dans la région Valognes-Barfleur-Saint-Vaast-la-Hougue. Le thème proposé était celui d'un parti bleu tenant la Seine depuis Paris jusques et y compris les côtes du Calvados et du Cotentin, Cherbourg compris. Le parti rouge tenait la rive Nord de la Seine et utilisait le Havre comme base, pour tenter de débarquer deux divisions, non pas sur les côtes du Calvados, mais entre la baie des Veys et Barfleur.
Il fut constaté avec nos camarades marins que nous manquions du matériel le plus élémentaire, ne fût-ce qu'en transmissions, pour réaliser un tel débarquement, malgré la faiblesse de la défense mobile de Cherbourg réduite d'après le thème à deux bataillons, un bataillon de chars et 2 groupes d'artillerie. L’escadre ennemie était représentée par le vieil aviso Ancre qui déploya tout son art à esquisser sous nos yeux, devant la fosse de Saint-Vaast-la-Hougue, un rideau de fumée assez peu impressionnant. La faiblesse des défenses terrestres de Cherbourg fut également évoquée, malgré l'intervention de notre camarade REVERS qui, du temps où il était à l’état-major du général MAURIN, avait réussi à obtenir la mise en état d'une batterie d'interdiction aux « Caplains », capable de tenir sous le feu de ses pièces à longue portée la plage de Carteret et celle de Saint-Vaast. Quant à l'aviation il faisait très mauvais temps et je ne me souviens pas de sa mission et de son rôle. L'objectif du débarquement restait la prise de Cherbourg, car nul ne pouvait concevoir le débarquement de matériel lourd sans la possession d'un port digne de ce nom, avec moyens de levage, entrepôts, etc. et nous ne disposions encore à l'époque que de quelques mahones et gabarres. En tant que « marsouins », MORLIERE et moi fûmes amenés à prendre la parole devant l'amiral DURAND-VIEL et pour ma part je n’en fus pas peu fier, car j'étais fils de marin et c'était mon pays, le Cotentin - que je connaissais bien - qui était attaqué. Qui pouvait prévoir que treize ans plus tard l'opération Overlord menée avec des moyens appropriés et des ports artificiels marquerait la libération du territoire national et de nos campagnes normandes. Le soir, mon ami et compatriote le commandant DUPONT, du cadre de l’École, qui avait préparé les cantonnements, me fit coucher à Valognes dans la chambre de BARBEY D'AUREVILLY. Bien que Valognes ait été à peu près complètement détruit en 1944, la maison, elle, n'a pas été touchée et je suis retourné l’an dernier sur la place de Saint-Vaast et à Tatihou. Quand on compare les moyens envisagés dans notre petit, tout petit thème de 1929 et les moyens déployés lors de l'opération Overlord, je comprends l'attitude de notre chef de promotion qui n'a pas décoloré au cours de ces trois jours de manœuvres, sans doute chapitré par les marins, très peu amateurs de ce genre d'opérations.
c) Voyage du Sud-Est ou des Alpes (été 1929).
Ce fut, avec un court voyage au polygone de Sainte-Adresse au Havre et la visite du Creusot le couronnement de la 2e année d'études.
La visite des usines Schneider au Havre et au Creusot, pour des officiers ayant presque tous visité la Ruhr ne nous apporta là non plus rien de bien nouveau sauf de nous convaincre de la nécessité pour un pays digne de ce nom de posséder une industrie puissante de fabrications d'armement. « II n’est pas plus intelligent d'être faible que d'être fort » a dit le Général WEYGAND.
Un des résultats les plus clairs de ces voyages et de ces contacts avec des ingénieurs, fut d'arrêter le mouvement de départ de l'armée, envisagé par certains stagiaires, peut-être déjà rongés par le scrupule de la paix éternelle ou soucieux de « valoriser » leurs connaissances pour améliorer leur condition matérielle et celle de leur famille. Presque toutes les enquêtes menées par les officiers auprès des ingénieurs sur les possibilités du secteur privé tombèrent à plat. Parmi les anciens polytechniciens, tous regrettaient d'avoir quitté prématurément la carrière des armes pour, sans doute, gagner un traitement supérieur, mais en perdant leur indépendance, leur liberté de pensée sans compter les vexations d’amour-propre et le sentiment de s'être déclassés.
d) Visite de Toulon.
La visite de Toulon où notre groupe eut la chance, grâce à mon camarade LEPORTIER, d'exécuter une plongée à bord du sous-marin le Narval au large de la « Bonne Mère » et d’aller à la rencontre de l'escadre qui rentrait de Marseille, nous fit toucher du doigt notre faiblesse maritime de l'époque. Sans doute la nouvelle batterie de côte en construction à Saint-Mandrier étendait-elle le champ d'action du front de mer, mais le front de terre restait bien dégarni. Puis le Toulon « éclair des sabres, flammes des mâts, lueurs des canons… » Toulon, ville de lumière et d'amour, de « Consolata fille du Soleil » et des « Petites alliées » était déjà bien mort. Le Toulon de 1908 et de 1910, qui avait orienté mes rêves d'adolescent vers les îles lointaines et parfumées et l’Extrême-Orient mystérieux, Saint-Mandrier, les Sablettes, Tamaris, même le restaurant du Père Louis étaient envahis par les « nouveaux messieurs » et puait le mazout. Toulon n'appartenait plus à la Marine et c'était tout dire. Là encore on ne devrait jamais repasser deux fois par le même chemin.
e) Le voyage des Alpes.
Le voyage des Alpes fut un voyage-éclair par excellence. Basé sur Nice, ce fut, contrairement à ce qui avait été fait les années précédentes, un voyage entièrement dirigé. Suivant la nouvelle formule, nous fûmes, dès notre arrivée à Nice, groupés sous la conduite du colonel CHAPOUILLY, spécialiste des Alpes et entraînés progressivement à la marche en montagne, terminant nos trois semaines de voyage par une ascension dans les règles.
Nous commençâmes par Peyracave et l'Authion où nous couchâmes dans les baraquements des alpins, puis après quelques amphis sur le secteur par le commandant BETHOUARD, les autocars nous ramenèrent à Nice et dès le lendemain nous prenions la route des Alpes qui, par Puget-Théniers, Entrevaux et le col d'Allos, nous mena dans la vallée de l'Ubaye et à Barcelonnette. Là nous eûmes une surprise. Au cours du dîner, le gendarme chef de brigade vint remettre au plus ancien un télégramme reçu de l'École et donnant le classement avec les affectations de sortie. C'était un « canular » assez bien monté avant le départ et qui empêcha de dormir quelques camarades. Le lendemain matin il y eut des discussions révélatrices et les visages ne reprirent le sourire qu'après l’arrêt au Châtelard. Nous remontâmes la vallée de l'Ubaye par la Condamine, et les forts de Tournoux, celle de l'Ubayette jusqu'au col de Larche et de Largentière, où il y avait encore de la neige sur la tête de Viraisse (2785 m). Puis, revenant sur nos pas jusqu'à Saint-Paul, nous allâmes chercher le col de Vars et Guillestre pour de là remonter jusqu'au château Queyras, par la vallée du Guil. Nous traversâmes la région très sauvage de l'Izouard sous un orage très violent. A Briançon nous commencions à constater les résultats de notre entraînement par l'ascension sans fatigue de deux ou trois forts, dont l’un commandait Abriès, l'autre le Mont-Genèvre, et donnait des vues sur les ouvrages italiens qui commandent la gare de Briançon.
Après 48 heures, nous reprîmes la route du Lautaret et de Grenoble puis celle du Galibier pour passer en Maurienne, laissant sur ta gauche l'imposant massif de la Meije et du Pelvoux, couverts de neige.
Au Galibier nous eûmes une émotion. Nous étions installés pour déjeuner au restaurant-refuge lorsque, en nous comptant, notre guide s'aperçut qu'il lui manquait un de ses suivants. Il fut facile de situer le camarade, quelques-uns d’entre nous se dévouèrent pour aller le chercher. Isolé sur une crête et pris de vertige, le malheureux n’osait plus descendre.
A Valloire nous vîmes les premières coiffes savoyardes et nous débouchions sur la vallée de l’Arc, tout à côté d’un petit ouvrage (Saint-Michel) perché sur la hauteur mais barrant magistralement le carrefour des deux routes.
D'étape en étape nous parvînmes ainsi à Modane, d’où après les divers amphis relatifs à la région (Vanoise, col du Fréjus et du Mont-Cenis) et à la position de Lanslebourg nous terminâmes le voyage par l’ascension de la pointe Franceschetti (3400 m d'altitude). Après avoir couché au refuge des Egvettes, au-dessus de Bonneval, nous partîmes avant le jour par un superbe clair de lune, encordés et encadrés par un détachement de chasseurs alpins et sous la conduite du colonel CHAPOUILLY et d'un guide, pour traverser le glacier et arriver à la pointe en fin de matinée. Nous arrivâmes sans trop de fatigue et après un tour d'horizon sur la vallée de la Doire Ripaire, Suse et la chaîne frontière, nous nous préparions à consommer un confortable casse-croute, lorsque nous fûmes saisis par un épais brouillard et pris dans un orage subit. Le guide et les chasseurs se précipitèrent pour éloigner nos piolets et bien leur en prit, car la foudre sous la forme de deux globes de feu éclata à quelques mètres. Ainsi confirmés dans nos connaissances de montagne, nous redescendîmes joyeux, considérant que nous avions bien gagné nos foudres…
Nous primes congé du colonel CHAPOUILLY qui s’était montré au cours de tout le voyage un chef et un instructeur aussi aimable qu'averti.
8 - L'amphi garnisons et la sortie de l’Ecole.
Nous nous retrouvâmes fin juillet à l'École pour l'amphi garnisons qui clôturait nos deux années d'études. Cet amphi garnisons qui décidait du corps d’armée ou de l'état-major de division qui devait, d'après les places disponibles el les besoin, fixer nos affectations au moins pour les deux années suivantes ne surprit personne Grâce à la bienveillance du général LANOIX qui avait tout réglé d'avance avec l'état-major de l’armée, chacun reçut à peu près l'affectation souhaitée, Certains devaient terminer leur temps de commandement de commandant (De LATTRE) ou de capitaines, d'autres partaient de suite aux théâtres d’opérations extérieurs (Maroc ou Syrie), d'autres enfin obtenaient le chef-lieu de corps d'armée on de région fortifiée, ou de division de leur choix, enfin d'autres, une dizaine environ, sortaient dans les divers bureaux de l'EMA. La 49e promotion but le pot de l'Amitié traditionnelle avec la 50e promotion, dont le chef, le commandant d'aéronautique LAHOULLE reçut le flambeau des Traditions solennellement du commandant DE LATTRE, après les discours et les toasts d'usage, et les rites étant accomplis chacun partit pour sa destinée et d'abord pour des vacances bien gagnées. Pour ma part, comme nouveau marsouin, j'aurais ambitionné de partir en Indochine, mais il n'y avait qu'une seule place et elle était réservée à MORLIERE qui sortait major de promotion. En réalité il y en eut deux mais la deuxième était réservée à LEMONNIER qui sortait aussi dans un excellent rang. Je partis pour la Syrie en octobre suivant, et par le plus heureux des hasards sur le même bateau que le commandant DE GAULLE que je connaissais déjà un peu et qui me prit avec lui au 3e bureau de l’état-major des troupes du Levant à Beyrouth. Je devais rester quatre ans en Syrie, deux ans à Beyrouth (1929-1931), deux ans à Damas (1931-1934), où je fis mon temps de commandement de chef de bataillon à la tête du 3e bataillon du 17e régiment de tirailleurs sénégalais dans une ambiance militaire exceptionnelle.
9 - Le destin de la Promotion.
Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, l'un d'entre nous, pendant qu'il en est temps encore, recherche et note la destinée de chacun et l'engage à écrire ses souvenirs.
Avons-nous justifié vis-à-vis de nous-mêmes et de nos chefs les efforts consentis par les uns et par les autres ?
Nous étions armés pour répondre là où notre destin nous a placé au cours d'événements qui ont été uniques dans l'histoire, aux devoirs qui nous incombaient et devant des cas de conscience qui devraient ne se présenter que rarement à des « officiers », mais qui semblent devenir périodiques. Au moins la moitié d'entre nous n'ont pas pu donner toute leur mesure mais tous ont servi en hommes de conscience et en hommes d'honneur.
Malgré ce qui est arrivé à certains lors des dégagements massifs de 1946 (50) et l'âge auquel la plupart ont dû quitter l'armée (54 ans), le bilan suivant que présente la promotion en 1959 (dégagés et retraités compris) constitue une somme de services qui n'est pas négligeable.
Français :
1 maréchal de France.
4 généraux commandants d'armée,
4 généraux commandants de corps d'armée.
6 généraux de division.
11 généraux de brigade.
2 ingénieurs généraux.
1 contrôleur général,
31 colonels et lieutenants-colonels dont 1 médecin-colonel,
1 chef d'escadron.
Total : 64
Étrangers :
2 généraux ambassadeurs,
4 généraux ayant exercé les fonctions de chefs d’état-major généraux.
4 généraux de division,
6 généraux de brigade.
1 colonel,
1 commandant.
Total : 18/23.
10- Conclusion.
Nous avons d'abord à nous incliner devant nos morts et au premier rang parmi eux, ceux qui ont été frappés du fait de l'ennemi.
Le Maréchal de LATTRE de TASSIGNY, mort pour la France k 11 janvier 1952.
Le général de brigade LEMONNIER, défenseur de Langson (Tonkin), décapité par les Japonais en mars 1945.
Le général de brigade MOREL, mort en déportation à Hambourg en 1942.
Le général de brigade VAUTRIN, mort au champ d'honneur en Tunisie en 1944.
Le chef de bataillon PARIS, chef d'état-major du corps expéditionnaire français, mort au champ d'honneur à Narvik (Norvège) en mai 1940.
et parmi nos camarades étrangers :
Le colonel BARRETT des US Marines, mort au cours de la campagne du Pacifique 41-43.
Le colonel EARL NAIDEN, des US Air Forces, mort des suites de ses blessures.
Le colonel CHMIELOWSKI, de l'armée polonaise, mort des suites de blessures (bombardement de Londres).
et à cette marque de respect il convient d'associer les fils de ceux d'entre nous qui sont tombés en Indochine ou en Afrique.
Je m'excuse d'avoir été prolixe et de m'être livré à des statistiques autant qu'à des réminiscences sentimentales. Telle qu'elle vous est présentée, la 49e Promotion, comme celles qui l'encadrent, de la 40e à la 55e, figure une époque, j'allais écrire une génération de brevetés. La 49e présente peut-être la particularité d'englober un aussi grand nombre d'officiers ayant servi avant 1914, et ayant fait ou terminé la première guerre mondiale et de compter dans ses rangs un bon tiers de jeunes entrés au service après 1919.
La préoccupation de celte génération a été la sécurité de la frontière. Peut-être serions-nous amenés à réviser nos données sur ce point de vue, en voyant plus large et plus loin, à la lumière de nos expériences et de nos études depuis 1946. En rentrant de Chine en 46, j'ai écrit, devant le désordre général des idées et des comportements, qu'il fallait repenser l'État, le Droit, l'Université, l'Économie, la Banque, la Défense Nationale. C'est maintenant doctrine d'État. Nous autres, brevetés de cette génération, nous y avons toujours pensé et en cours de chemin nous rencontrions peu de monde. Les préoccupations étaient ailleurs et nous passions pour des pêcheurs de lune. Actuellement cela a heureusement changé.
VIS-A-VIS DE L'ÉCOLE je ne voudrais pas à ce titre paraître un censeur et formuler des critiques déplacées. Elle a formé cette génération et c'est tout dire et donné un enseignement de tradition lui aussi, mais qui était aussi une méthode. Peut-être aurait-on pu dès l'époque, comme on le fait actuellement, nous sortir de notre isolement intellectuel, mais qui serait venu vers nous ? Et qui nous aurait donné les moyens matériels d'entrer davantage en contact avec la Vie, c'est-à-dire le monde de notre temps ? Peut-être aussi aurait-on pu augmenter les contacts avec la troupe et le matériel, mais à la réflexion, en pleine période de décadence militaire, comme nous l'étions à l'époque, décadence connue, sinon voulue, à côté de ce qui se tramait près de nous, devant nous ; décadence recherchée et sublimée par les niaises déclarations de 1924 et années suivantes, déclarations, de la paix au monde, tractations de Genève, etc. c'était mieux ainsi.
Quelques encouragements venus d'en haut auraient été les bienvenus dans les moments de désarroi et de doute. Car il est un grand principe qui règne sur l'École ; c'est celui du maintien des forces morales. C'est là le grand mérite des fondateurs et des dirigeants de l'École comme jadis les LEWAL, les LANGLOIS, les BONNAL qui nous ont donné le bon sens d'un FAYOLLE, l'étincelle d'un FOCH et aussi l'équilibre d'un FAYOLLE ou d'un FRANCHET d'ESPEREY. Ils ont su ranimer et entretenir chez de jeunes officiers, après la défaite de 1870, les saines notions de la valeur des armes et de la puissance de relèvement de la Nation, et aussi la probité intellectuelle indispensable à tout travail utile. Cela suffirait presque, avec le contact des réalités, à créer une doctrine et cette doctrine nous sauve actuellement. Mais il ne faut pas s'en tenir là. Notre génération, les officiers au premier rang, a eu la chance de courir le monde, de s'initier à des civilisations nouvelles, des techniques nouvelles, et ce faisant de réfléchir à la plupart des grands problèmes de demain, dont le côté humain apparaît beaucoup mieux. Cela c'est le Mouvement et par conséquent la Vie, gui n'est ni bonne, ni mauvaise parce qu'elle est simplement la Vie. « Lege, scribe, tace » soit, mais il faut y ajouter « canta ». Et, comme le dit M. THIERS, « S'il est bon d'être allé à l’École, il ne faut pas y rester ».
*
* *
Le chef de bataillon de Lattre de Tassigny, chef de la 49e promotion
par le général LAVAUD
Le 5 novembre, 1927 le chef de bataillon de Lattre de Tassigny entre à l'École de guerre. Précédé d'une réputation peu commune d'homme d'action acquise au Maroc dans les postes déjà élevés où il a servi, son grade et son ancienneté le désignent aussitôt comme chef de Promotion.
Ce titre lui plaît. D'abord il le distingue des autres officiers de la 49e promotion. Puis de Lattre saisit tout de suite le parti qu'il petit tirer de cette prééminence. Il compte bien en effet, grâce à cette situation particulière, mener une action personnelle, tant auprès du commandant de l'École que de ses camarades, pour imprimer à cette promotion une marque qui sera la sienne.
Il prend immédiatement des mesures d'organisation, désigne un secrétaire, lui fixe ses attributions, persuade les chefs de groupe du rôle qu'ils doivent jouer, précise leur action qui doit dépasser largement le cadre normal des petites servitudes de la tâche journalière.
Il réunit plusieurs fois la promotion, lui parle, lui insuffle sa flamme et lui imprime rapidement une personnalité qui s'affirme tous les jours davantage au cours des deux années.
Malgré l'importance des travaux qui laissent peu de liberté aux officiers, il sait, avec le sourire, imposer aux chefs de groupe l'organisation de conférences au cours desquelles des camarades sont appelés à prendre la parole dans des domaines où leur compétence est connue.
Cet esprit de promotion est développé au maximum par ses soins pendant les voyages ou les exercices à l'extérieur, quand le contact direct, fréquent et prolongé, multiplie la puissance de ses dons de persuasion.
Toutes les occasions sont exploitées pour assurer une cohésion plus intime non seulement dans le sens de l'aide réciproque mais aussi dans celui de la qualité et de la grandeur.
Il attache une importance particulière à ce que les nombreux officiers étrangers qui font partie de la Promotion gardent de leur séjour en France une impression profonde et favorable. Il ne néglige rien pour que leur soit facilitée l'assimilation d'un enseignement développé dans une langue qui est loin d'être familière à tous. Il est gentil avec eux, il les reçoit et, dans de longues causeries, essaie de créer des liens qu'il estime indispensables et fructueux pour l'avenir. Il se lie même d'amitié avec certains d'entre eux.
A la fin de « l’amphi garnison », le dernier jour de présence à l'École, de Lattre exalte ce sentiment au cours d'une belle improvisation. Il jette les bases de l'Association des Anciens de la 49e promotion qui eut une vie très active jusqu'en 1939. Il est nommé président par acclamation. Les réunions annuelles rassemblaient toujours un nombre important d’officiers dont l’attachement à leur président apparaissait plus particulièrement touchant à cette occasion.
De Lattre, qui en était très fier, a toujours fait une place à part à ceux de la 49e ; bien des années après avoir quitté la place Joffre, même et surtout au sommet de sa gloire, il leur a toujours manifesté une attention affectueuse et une bienvenue chaleureuse.
Cette action de tutelle de la promotion qui, sous un angle particulier, n'est toujours qu'une des manifestations de son tempérament de chef, il la conduit en pleine liaison avec le commandant de l'École pour le plus grand bien de tous et le meilleur rendement du haut enseignement militaire dispensé à l'École.
Avec le général Hering, puis le général Duffour qui ont successivement commandé l'École supérieure de guerre pendant cette période, le commandant de Lattre a de fréquents entretiens desquels il rapporte toujours des mesures qui servent au mieux l'intérêt général.
Dans ses rapports avec les chefs de cours et les professeurs, sa déférence est absolue, mais sa personnalité déjà accusée accepte difficilement la qualité de « disciple » quels que soient les ménagements pris très élégamment à son égard. Il souffre quand la solution qu'il a défendue n'est pas adoptée, en particulier, il a peine à admettre qu'un instructeur moins ancien que lui ne partage pas son point de vue.
Admis très brillamment au concours d'entrée, il ne cesse de se tenir dans le peloton de tête et il sort dans les tout premiers de l’École. Ces résultats étonnamment constants, il les doit à son intelligence lumineuse, à sa puissance de réflexion, à sa faculté, de toujours saisir le nœud d'un problème, à son art d’exposer simplement et de mettre en valeur les points essentiels.
Il aime commander, donc prendre les décisions, les marquer de mots frappants, discuter longtemps leurs avantages, chercher leurs inconvénients, mais il déteste écrire le détail, régler les problèmes mineurs. Pour lui tout tient dans la pensée du Chef. Aussi déjà à l’École de guerre constitue-t-il une équipe de travail qu'il anime.
Dans cet esprit il réunit avenue de Versailles pour des travaux à domicile un certains nombre de familiers.
Contrairement à ce que certains peuvent penser, il ne craint pas la contradiction, il la souhaite au contraire, il la provoque, il y trouve des arguments dont il sait, le moment voulu, tirer infiniment de parti. Mais cette opposition aux idées qu'il émet, il ne la veut que loin des regards indiscrets, à l’intérieur du groupe qu’il a constitué et tant que le point final n'est pas arrêté.
Il sait profiter des connaissances de ceux que l'expérience militaire a déjà solidement charpentés. Il ne dédaigne pas pour autant les avis des jeunes dont l’optique, pour moins classique, lui plaît infiniment par son dynamisme et son goût du neuf. Il ne manque jamais de panacher son équipe.
Mais il sait déjà ménager ceux dont il devine le brillant avenir avec le flair pénétrant qui l'a tant servi par la suite. Dans la 49e Promotion quelques officiers sont parvenus à des postes considérables, il est juste de reconnaître qu'il les avait déjà distingués.
Dans les travaux personnels en salle, un peu moins à l'aise, il lui manque le tonifiant qui constitue pour lui le besoin de dominer au vu et au su de tous. Il rédige assez lentement par lui-même, revient sur son texte, le modifie sans cesse, finalement fournit un document dont l'exécution n'est pas toujours à la hauteur de l’idée qui l'anime.
Au cours du séjour à l’École, deux longs voyages d'études sont organisés qui conduisent traditionnellement les promotions, an cours de la première année dans le Nord-Est, puis en fin de stage sur la frontière Sud-Est.
Pendant ces voyages une grande liberté est laissée à chacun, sous réserve d'une présence obligatoire en certains points à jour fixé, pour un exposé assorti de discussions sur un sujet militaire ou économique, suivi fréquemment de la visite de gros ensembles industriels.
C'est sans doute pendant ces périodes qu'il était possible à ceux qui avaient la bonne fortune de voyager avec lui, ou qui le retrouvaient le soir au gîte de l'étape de voir de Lattre sous son aspect le plus naturel.
Il avait avant le départ préparé, personnellement son itinéraire avec un soin méticuleux, grâce aux informations rassemblées aux sources, sur les sujets les plus divers relatifs aux régions traversées. Sa vaste culture le mettait à l’aise aussi bien dans les problèmes militaires que dans les questions d'histoire, de géographie, d'architecture, de géologie, de démographie.
C'était un compagnon charmant particulièrement sensible à tout spectacle d'où émanait un air de grandeur. Les beautés de la nature ne le laissaient jamais indifférent, qu'il s'agisse des champs de bataille d'Artois traversés un soir d’orage effroyable où les trombes d'eau d'un rouge vif coulaient entre les trous d’obus, de Bruges, aux monuments exquis avec ses vieilles maisons tapissées de lierre, du château d'Ardennes au parc d'une majesté incomparable, de l’abbaye de Clervaux où l’accueil des Bénédictins fut un véritable salut à la France.
Il trouvait toujours les mots justes pour exprimer les sentiments que chacun sentait confusément et faire revivre l'histoire dont toute cette région était infiniment riche. Il possédait de nombreux souvenirs personnels qu'il se plaisait à raconter très simplement et qu'il disait avec beaucoup d'agrément.
Marié quelques mois avant d'entrer à l’École, Bernard lui était né en février 1928. Ce fils dont il était si fier, il en parlait fréquemment avec gentillesse, d'un mot bref, d'un rappel de caprice d'enfant quand les hasards de la route ou d'une conversation frappaient sa fibre paternelle.
Sa femme était déjà pour lui la collaboratrice ardente et dévouée à laquelle il demandait beaucoup, mais dont il suivait volontiers les avis, soulignant toujours d'un mot charmant sa soumission apparente. Il l'adorait et pendant les voyages, si loin qu'il fût, du fond de la Belgique comme des auberges des lointaines vallées alpestres, il ne manquait jamais de l'appeler affectueusement chaque soir au téléphone.
Elle accueillait toujours avec grâce et simplicité les familiers qui se réunissaient souvent dans le petit appartement de l’avenue de Versailles pour y discuter, jusque tard dans la nuit, sur tel ou tel sujet de tactique générale. Elle avait sa part dans la préparation des documents de travail et la mise au net des études de son mari.
Elle l'admirait et le servait au sens le plus élevé du terme.
Dans cette courte période qui représente le début de sa formation aux commandements élevés, de Lattre se révèle déjà tel que la légende l'a fixé comme grand Chef.
Alors qu'aucune responsabilité ne lui incombe normalement, il recherche toute occasion de dominer.
Tour à tour charmeur et brutal, toujours exigeant, le maniement des hommes le passionne.
Infiniment sensible, sa première question avant de porter un jugement tant sur un inférieur que sur un camarade ou un supérieur était toujours : « M'aime-t-il ? ».
Poursuivant avec beaucoup d'amour-propre la satisfaction de ses légitimes ambitions, il croyait en son étoile. Critiqué par certains, adoré par d'autres, l'unanimité se faisait immédiatement chez ses condisciples pour rendre hommage à sa valeur qui s'annonçait pleine de promesses.