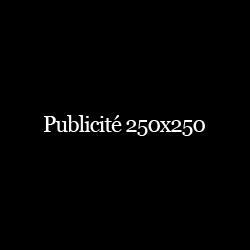Promotion 1931
La liste des 80 admis de la cinquantième-troisième promotion paraît au Journal officiel du 27 février 1931 : 39 sont de l’infanterie, 8 de la cavalerie, 15 de l’artillerie, 3 du génie, 4 de l’aéronautique, 10 de l’infanterie coloniale et 1 de l’artillerie coloniale.
Les stages préalables à l’entrée à l’École, d’une durée de six mois, débutent le 16 mars 1931. La partie commune, jusqu’au 30 mai, se déroule à l’École d’application d’artillerie (automobiles et projecteurs), à l’École de liaison et transmissions, dans l’aviation et dans les chars de combat. La seconde partie a lieu du 15 juin au 30 septembre, dans l’infanterie, dans l’artillerie et dans la cavalerie, avec des durées de stage adaptées à l’arme d’origine des officiers. Pendant le mois de juin, les officiers de l’aéronautique assistent à des tirs de DCA d’une durée d’une semaine.
Après une permission de trente jours, les stagiaires rejoignent l’École supérieure de guerre le 3 novembre 1931. Ils sont rejoints par l’intendant militaire de troisième classe REYNAUD et le médecin-capitaine FIQUET, désignés sur titres pour suivre la première année de scolarité, et par le capitaine FREMIOT de la promotion précédente..
A leur arrivée, le général DUFOUR, commandant l’École, leur donne quelques conseils.
Vingt-quatre officiers étrangers suivent également les cours. Le général DUNLAP, désigné en janvier 1931 pour suivre les cours de la 53e promotion, est mort accidentellement en mai 1931 peu après son arrivée en France.
Le stage se termine le 3 novembre 1933 ; tous les officiers sortent brevetés.
Cinq officiers de cette promotion sont morts pour la France pendant la Seconde guerre : BOURGEOIS, CHAUDIERE, DE LAMBILLY, DUPUIS et FEUVRIER.
Les colonels Van Belle et Sassier ont publié en 1969, dans le n°42 du Bulletin trimestriel des amis de l’École supérieure de guerre leurs Regards sur la 53e promotion.
*
* *
Conseils aux officiers français de la 53e promotion
par le général Dufour, commandant l'École supérieure de guerre
« Trois mots brillent en lettres d'or sur notre grille d'entrée : ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE. Ils évoquent toutes les idées dont vous devez vous imprégner pour faire honneur à l'enseignement que vous avez désiré recevoir.
1. Le terme « schola », d'où dérive « école », signifie doctrine, système, en même temps qu'étude. C'est à ce dernier sens seul que vous devez vous attacher.
Vous ne venez pas ici, en effet, pour acquérir un corps de doctrine conçu par des professeurs, et par eux érigé en système dont vous deviendrez ensuite les tenants dans l'état-major, c'est-à-dire auprès du commandement, où dans la troupe, c'est-à-dire auprès des exécutants.
La doctrine tactique française existe indépendamment de l'École de guerre. Elle est formulée dans nos règlements qui valent pour toute l'armée et qui marquent l'état présent des idées admises pour la conduite et l'exécution des opérations de guerre eu égard aux propriétés de l'armement et à l'état de la machinerie.
Ces règlements, l'enseignement de l'École s'y réfère, les commente, se les incorpore même et par conséquent en respecte toujours les prescriptions et la terminologie ; mais sa raison d'être n'est pas là ; le but qu'il vise est plus élevé.
Vous êtes à l'École de guerre pour des études qui doivent, à l'aide de la raison comme à la lumière du passé, vous initier à la fois :
- aux conditions du maniement en guerre des grandes unités tactiques, ce qui est le rôle des premiers échelons du haut commandement ;
- au métier des états-majors, auxiliaires de ce même commandement.
Ces deux catégories d'études sont connexes : l'officier d'état-major est d'autant plus à hauteur de sa tâche qu'il a plus réfléchi aux problèmes que pose l'exercice du haut commandement en campagne. Nous l'avions oublié en France après les guerres du Premier empire ; les Allemands nous l'ont rappelé en 1870, heureusement sans nous entraîner à leur suite dans l'erreur grave qui consiste à identifier l'état-major et le commandement pour le plus grand dommage du second.
Leçons de commandement et leçons d'état-major, en toutes circonstances de guerre, voilà les deux disciplines que vous êtes appelés à suivre. Elles s'adressent à des facultés et, par suite, à des qualités de nature différente ; vous ne tarderez pas à l'éprouver. Quand une même tête y excelle, il faut la priser haut.
Mais le terme ECOLE pourrait faire songer à un régime de contrainte et de compétition, où la faveur d'en haut irait aux disciples qui savent se plier avec le plus d'à propos et de souplesse aux opinions des maîtres, dussent-ils même leur sacrifier des convictions. Chassez cette image, si elle vous vient. Vous accédez à un enseignement de l'ordre supérieur et n'aurez l'estime de vos professeurs que dans la mesure où vous serez direct, sincère, maître de votre pensée et de votre jugement.
2. Dans les écoles de formation où vous avez acquis vos galons d'officier, vous avez appris pour savoir et pour savoir apprendre ; et c'est encore pour ce double objet qu'on vient de vous faire accomplir des stages d'arme.
A l'École supérieure de guerre il vous faudra, certes, acquérir encore beaucoup de connaissances nouvelles, tant en améliorant votre faculté d'assimilation (le « savoir apprendre »), mais, de plus, et surtout, vous devez apprendre à chercher pour votre compte, à découvrir à votre tour. Cela n'est rien moins que la mise hors tutelle, que l'émancipation, dans le domaine tactique, de votre pensée et de votre volonté. La faculté d'assimilation restera toujours en jeu ; mais progressivement le premier rôle doit passer aux facultés d'invention et de décision.
Les méthodes d'analyse et de synthèse qui permettent cette émancipation vous seront expliquées et inculquées par vos professeurs, dont les leçons seront essentiellement objectives et fondées sur le concret. Il suffit donc, ici, de marquer le caractère de l'effort qu'on attend de vous.
Qui dit « enseignement supérieur » dit spécialisation, travail en profondeur, exploration d'un ordre de connaissance par coups de sonde en des points insignes où la vérité que l'on cherche semble devoir livrer ses secrets les plus importants. Ne vous attendez donc pas que vos professeurs s'évertuent à vous présenter une encyclopédie de la tactique et du service d'état-major en campagne ; ils n'en auraient pas le temps et, s'ils l'avaient, c'est vous-mêmes qui bientôt leur demanderiez grâce. Non. Vos professeurs vous amèneront aux endroits les plus typiques du domaine ouvert à vos recherches, vous en expliqueront les particularités et vous aideront à tirer de ce voyage et de cet examen des conclusions de portée pratique, toujours, et, s'il y a lieu, philosophique. A vous, ensuite, d'utiliser ces grands jalons pour enchaîner votre savoir et atteindre à la pleine intelligence des principes et des procédés.
Vous comprenez, de piano, qu'une telle discipline n'est profitable à ceux qui la suivent que s'ils se font du labeur personnel et individuel une loi absolue. Je ne veux pas dire qu'il importe de vous isoler ; d'éviter les échanges d'idées, voire les discussions ; de ne point vous enquérir des lectures utiles ou des documents nécessaires. J'entends simplement que dans la préparation immédiate et l'exécution d'un travail donné, vous soyez vous-même de bout en bout, n'empruntant à d'autres ni le jugement qui propose, ni la volonté qui dispose.
Mis en face d'un problème, considérez-le d'abord avec soin pour en bien saisir la nature et les données. Puis, par la lecture et la réflexion, armez-vous pour l'attaquer, sans vous préoccuper de la manière dont les camarades vont s'y prendre. Une fois armés, attaquez-le carrément et, s'il s'agit d'un travail à domicile, avant que le délai dont vous disposez ne tire à sa fin : ceux qui tardent toujours à s'engager versent fatalement dans le velléisme. Maîtres d'une solution, tenez-vous-y fermement, en dépit des repentirs que pourront vous infliger les commentaires d'autrui, car il est rare qu'un problème de tactique ou d'état-major n'offre qu'une issue. Aussi bien, l'application très méthodique d'une solution très ordinaire conduit-elle au succès.
En vous comportant de la sorte, vous ferez l'éducation de votre esprit, vous le rendrez pénétrant et productif, capable d'aller au fond des questions et d'en extraire l'essence.
Vous fortifierez aussi votre caractère, ce qui est le fondement même de votre préparation à la guerre.
3. Que la guerre reste possible ou qu'elle soit à jamais abolie dans une Europe apprivoisée par la société des nations, c'est un débat dont il faut vous abstraire dans l'exécution de votre tâche. Pourquoi ? Parce que le plus élémentaire de vos devoirs d'état est de vous préparer à la guerre comme si elle devait éclater demain.
Or la guerre, il est aussi banal de le dire que nécessaire d'y songer, est avant tout une lutte de volontés. Et la volonté se cultive autant par la conduite rigoureuse de l'effort intellectuel que par la résistance aux épreuves morales ou physiques. Les hommes qui possèdent, avec le contrôle de leur activité cérébrale, le courage de la pensée, sont des forts auxquels les autres courages, celui de l'âme et celui du corps viennent en général de surcroît. D'où l'importance du labeur personnel et individuel, animé, soutenu par la foi militaire.
Mais votre préparation immédiate à la guerre tiendra à d'autres conditions encore. La guerre, répète-t-on, doit se faire aujourd'hui avec des machines ; c'est bien vrai, et vous constaterez vite que la tactique est devenue pour une grande part une science, la science de l'emploi des engins de guerre. II n'empêche qu'en fin de compte la machine est toujours actionnée par l'homme : si les possibilités de l'homme viennent à être perdues de vue dans les calculs de la tactique, ceux-ci ne peuvent que faillir. Là gît évidemment la plus grave difficulté de l'enseignement que vous allez recevoir, car il est impossible de faire intervenir le facteur humain avec toute sa complexité dans les fictions que constituent vos exercices et vos travaux.
Vous devrez par conséquent vous astreindre, avant d'arrêter une combinaison de tactique ou d'état-major, à en imaginer toujours la mise en œuvre réelle, dans le temps et l'espace, par les exécutants. Vos maîtres y tiendront la main, en vertu même de la consigne qu'ils ont de vous rappeler sans cesse aux réalités de la vie en campagne et du champ de bataille, et de vous mettre en garde contre l'idée trop répandue que le service d'état-major en temps de guerre consiste à se confiner dans des quartiers généraux pour y rédiger des ordres académiques.
Au surplus, votre programme d'études comprend des conférences et des voyages qui ont précisément pour objet de vous retremper dans ces réalités ; de mettre sous vos yeux, en pleine lumière, toute la distance qui existe entre les spéculations d'école et la pratique effective de la guerre ; de vous montrer par conséquent la souveraine influence des forces morales sans lesquelles aucun succès n'est entier, avec lesquelles aucun échec n'est définitif. Ces conférences et ces voyages forment le cours d'HISTOIRE MILITAIRE, indépendant de tous les autres et placé au-dessus d'eux dans le service de la vérité. Une École de guerre où ce cours, je ne dis pas manquerait, mais seulement végéterait, une telle École serait comme une âme sans conscience.
Au travail donc, joyeusement, avec ardeur et avec confiance !
S'il vous faut un dernier critérium pour déterminer cette confiance et cette ardeur, regardez vos camarades étrangers qui savent bien, eux, pourquoi des quatre coins du monde on les a dirigés sur l'École de guerre de Paris et mesurez ce que la paix européenne doit au prestige de l'Armée française ».
*
* *
Regards sur la 53e promotion
par les colonels VAN BELLE et SASSIER
Article paru dans le Bulletin trimestriel des amis de l’École supérieure de guerre n°42 (janvier-avril 1969).
Notre promotion entra à l'École au lendemain de la crise économique de 1929, un moment où la vie à Paris était particulièrement dure : l'armée dut prendre quelques dispositions d'ordre financier pour qu'un nombre suffisant de candidats valables se présentent à l'examen d'entrée. La promo a formé un bloc assez cohérent et dans l'ensemble sympathique ; et c'est avec une certaine nostalgie que l'on revit en pensée les deux années d'une lointaine jeunesse.
On nous permettra d'évoquer au hasard quelques-uns d'entre nous. CHOMEL, major d'entrée, n'a laissé que de très bons souvenirs. PIOLLET, aviateur, s'est fait remarquer à l'écrit par un thème tactique fumant. Le correcteur brandissait la copie sous le nez de ses collègues : « Qui de vous, messieurs, en ferait autant ? » PIOLLET fut donc mis sur la sellette à l'oral et même retourné sur le grill. Il termina au sommet de la hiérarchie, et c'est fort bien ainsi.
Faute d'autre critère, DE BEAUVILLE, l'œil aigu derrière son monocle, notait l'éducation de chacun ; comme pour le classement à l'entrée, toute la promo s'estimait dans le premier tiers. Le secrétaire de promotion, le marsouin BOUSQUET se dépensait avec discrétion. KREBS, dialectique, justifiait toujours ses décisions « pour trois raisons », mais son exposé nous en révélait la première, parfois la deuxième, jamais la dernière.
Parmi les camarades étrangers, STUTESMAN nous fit un jour un amphi sur l'armée américaine. Comme il estimait son français embryonnaire, il entra ainsi en matière : « Si vous assistez à une course de taureaux, et si le public est mécontent du toréador, il crie « assassin ». Quand vous m'aurez entendu, j'ai grand peur que vous ne disiez vous aussi : « assassin ». Son humour s'exerçait en mainte autre circonstance. Il me souvient d'un exercice où, dans une situation extrêmement mouvante, un instructeur lui demanda : « Quelle mission donnez-vous à votre artillerie lourde ? » - « Faire du bruit », répondit-il, imperturbable, montrant ainsi toute l'importance qu'il attribuait à l'action des forces morales dans le combat.
Le corps professoral nous a laissé des impressions assez disparates. Hautain et glacé, le général DUFFOUR supervisait l'instruction. « Si vous ne savez pas analyser rapidement une situation, si vous ne pouvez l'exposer clairement, vous serez de ceux qu'on n'emmène pas en reconnaissance et vous resterez à l'arrière à paperasser ». Est-ce la raison pour laquelle il a tant écrit ? On lui attribuait, en les déformant quelque peu, d'autres aphorismes : « Toutes les solutions sont bonnes ; seule est admise celle de l'École. »
Le général HARTUNG s'intéressait à notre vie personnelle et nous manifestait une affection toute paternelle. A la première confession, il demanda à l'un d'entre nous avec quel officier étranger il s'était lié. Apprenant que rien n'était encore fait, il protesta vivement. Le général voyait juste : DE LOMBARES (60e promotion) a montré l'importance capitale de ces liens d'amitié.
Le colonel LOISEAU régentait la tactique générale. Rigide et avare de ses mots, il semblait avoir avalé son sabre, un tout petit sabre droit, bien entendu. Il nous fit distribuer un gros ouvrage de son cru : Combat du corps d'armée dans l'armée, portant son exergue : « Si je combats, je gagne » (Confucius), ce que VAN BELLE traduisait pour la galerie : « Si je fais le..., je gagne. »
Un de ses adjoints, le colonel MOUTON, dispensait son enseignement dans une discipline toute napoléonienne et avec une conscience laborieusement scrupuleuse. Au cours du voyage de deuxième année, ZELLER, commandant le corps d’armée ami, se tira fort élégamment de sa tâche, mais sans schéma. Condamné en conclave (fâcheux présage), il demanda le rapport du colonel et fut réhabilité ex-cathedra. Dans sa carrière mouvementée, il préféra ne pas renouveler semblable démarche, qui n'eut probablement pas eu le même succès. SASSIER, commandant le corps d’armée d'en face, fut lui aussi mis au pilori. Il n'eut pas l'audace de réclamer et ne parut pas en souffrir.
Le colonel MENDRAS dirigeait d'une main ferme le cours d'artillerie. Ennemi de tout schéma, il nous plaçait dans les situations les plus imprévues et critiquait vertement les décisions purement scolastiques : « Je vous blâme », s'écriait-il. En 1939, commandant l'École, il fut le premier à faire étudier le combat de deux divisions blindées. Il est vraiment dommage qu'il n'ait pas été appelé à ce poste quelques années plus tôt. Le colonel BREGEAUD appliquait la méthode du maître avec une bonhomie sans pareille. Ayant confié à GENEVEY l'exposé du déploiement d'un groupe d'artillerie, et voyant celui-ci escamoter le délicat problème du « masque », sarcastique, il tendit à GENEVEY... un sitomètre. L'histoire ne dit pas si l'intéressé reconnut l'instrument. Une autre fois, ayant demandé à CACHOU de faire un tour d'horizon, il vit d'un œil apparemment amusé, le disciple, froid logicien, tourner le dos au paysage et décrire le terrain d'après la seule carte qu'il avait déployée, après avoir déclaré s'en remettre avec plus de sécurité à la précision consciencieuse du géographe, auteur de la carte, qu'au hasard d'un examen rapide et nécessairement superficiel du terrain.
Le colonel DE LA FONT menait le cours de cavalerie d'une main sûre et ses solutions étaient d'une élégante clarté.
Le colonel DAME dirigeait le cours d'infanterie avec une autorité indiscutée. Un peu distant, il goûtait peu la plaisanterie. Et certains se souviennent du garde à vous assez crispé qu'il piqua au moment où, au cours d'un voyage tactique, toute la promo réunie autour d'une immense table en fer à cheval se disposait à prendre place, une insolite Marseillaise jaillit subitement d'un vieux phono nasillard. Quel était le responsable ? On hésitait entre VAN BELLE et SAINT-SALVY, le plus sarcastique de nous tous, et qui était aussi le plus secret, ce qui le prédisposait au dangereux travail clandestin qu'il accomplit après l'armistice, au sein du service démographique, organisme de mobilisation astucieusement camouflé.
Un des adjoints du cours d'infanterie exposait un jour la progression d'un bataillon de deuxième échelon en 1915. GILOTTE, qui avait été dans le coup, trépignait de rage. Ses voisins, se cramponnant à lui, eurent toutes les peines du monde à l'empêcher de protester. Vit-on jamais la doctrine s'incliner devant les faits ?
Le commandant JAUBERT nous initiait aux mystères du génie. Au cours du voyage du Nord-Est, il nous annonça qu'il allait nous exposer la bataille de Saint-Privat. DUPUIS fit remarquer innocemment « qu'il n'y avait pas de « pendu » d'Histoire ». Le commandant JAUBERT, visé, se retourna, et le regard torve derrière ses lunettes, explosa de sa voix de basse : « Pourquoi faire ? » Et il nous exposa la bataille avec des accents qui nous tirèrent les larmes des yeux.
Le colonel MENDIGAL enseignait l'aviation. Instructeur de grande classe, conférencier hors ligne, il nous passionnait dans l'étude ingrate d’un plan de recherche de renseignements.
Savoir s'adapter, telle est la grande leçon de l'Histoire porte en exergue un cours du colonel LESTIEN. Avons-nous su le faire ? Le colonel HAUTECŒUR nous ravissait par sa verve et son esprit mordant. Il nous quitta subitement, peu de temps après nous avoir relaté le comportement d’un groupe de divisions de réserve au cours des premiers combats dans la Woëvre en 1914, pénible et prophétique réalité qui ne cadrait pas avec les illusions des inventeurs des divisions de série B. Le commandant THIERRY D'ARGENLIEU nous décrivit sur le terrain les combats d'août 1914 sur la Sambre. Au retour de ce voyage, remontant le Champ-de-Mars avec un stagiaire, il lui demanda si la promo avait été satisfaite. Pris de court, mais voulant faire sentir que le conférencier avait été compris, l'interpellé répondit : « Vous nous avez appris que l'on ne fait pas de l'Histoire militaire seulement avec son cerveau, mais aussi avec son cœur. »
La promo avait naturellement ses jeunes turcs que le corps enseignant mettait complaisamment en vedette. Aussi, le classement officiel de sortie présentait-il quelques différences notoires avec celui que les stagiaires avaient en tête. La variable aléatoire introduite dans la course par les circonstances et les incidents de parcours a quelque peu déjoué ces divers pronostics, confirmant ainsi le rôle prédominant du facteur hasard, plus grand que Zeus et Allah réunis.
La promo a compté 29 officiers généraux : 18 de brigade, 3 de division, 2 de corps d'armée, 3 d'armée, 3 contrôleurs généraux. Proportion inférieure au score de la 60e (maréchal LECLERC), mais supérieure à la 11e (maréchal FOCH). On pourrait d'ailleurs se demander quelle conclusion proposerait un ordinateur auquel auraient été fournis ces éléments statistiques ?
Quoi qu'il en soit, la 53e promotion a la conviction de ne pas avoir démérité. Elle garde religieusement le souvenir de ses cinq camarades morts pour la France. Trois sur le sol métropolitain : BOURGEOIS, CHAUDIÈRE, FEUVRIER. Un en Italie : DE LAMBILLY. Un en déportation : DUPUIS.
Elle y associe la mémoire de deux de ses instructeurs : le général THIERRY D'ARGENLIEU, emporté dans la tourmente de la 9e armée et le général DAME, tombé à Lille en 1940, au milieu des fantassins de sa belle division
*
* *
La 53e promotion au camp de Mourmelon (Coll. privée).