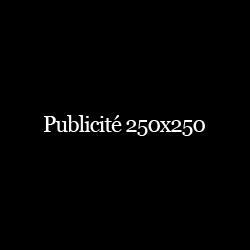L'ECOLE D'APPLICATION DU CORPS D'ETAT-MAJOR
Soldat de l’An
II, capitaine par voie d’élection, officier d’état-major en tant qu’adjudant
chef de brigade puis adjudant-général, général de division en 1794 et titulaire
du brevet de « premier lieutenant de l’armée » décerné par le
Premier consul en 1799, conseiller d’État, ambassadeur mais surtout chef de
guerre, le maréchal Gouvion Saint-Cyr était l’un des plus talentueux
lieutenants de l’Empereur. Il s’est rallié aux Bourbons sans se renier en
politique.
Pendant deux
ans, de 1817 à 1819, en présence des baïonnettes étrangères encore rassemblées aux
frontières, il entreprend comme ministre de la Guerre une œuvre fondatrice pour
l’armée du XIXe siècle et s'empresse de la doter d'un corps d'état-major, tel
que son expérience éclairée l'avait conçu et mûri. En effet, sa méthode
personnelle de commandement lui avait fait sentir les insuffisances des
états-majors à la fin de l’Empire. « Des
aides de camp aussi braves qu’élégants, mais désignés par la faveur ou
l’amitié » manquaient trop des connaissances indispensables pour
remplir avec fruit le rôle d’intermédiaire entre le chef et ses troupes.
Il avait
compris depuis longtemps que la considération, le respect que doivent commander
les officiers d'état-major dans toutes les exigences de leur service devaient être
conquis par une instruction solide et variée, comme leurs attributions le sont
elles-mêmes ; qu'enfin la meilleure garantie de cette instruction serait
dans la création d'une école où l'on enseignerait tout ce qu'il importe à
l'officier d'état-major de bien connaître, et qui aurait seule le privilège de
recruter l'état-major de l'armée.
C'est donc
pour obéir à une conviction que partageaient d'ailleurs les généraux les plus
distingués de l’époque, que le maréchal Gouvion Saint-Cyr rédige et fait
approuver l'ordonnance du 6 mai 1818 portant
création du corps royal d'état-major et de son école d'application.
Le 2 juillet
1818, en exécution de l'ordonnance du 6 mai 1818 portant
création du corps royal d'état-major et de son école d'application, le maréchal
de camp Desprez est nommé au commandement de l’École. C'est autant au crédit du
général de Clermont-Tonnerre, autant qu'à sa valeur personnelle, qu'il doit sa
réintégration dans les cadres et sa nomination à la tête de l'École.
Sorti de l'École
polytechnique au premier rang des élèves de sa promotion, le général Desprez avait
servi avec une grande distinction, d'abord comme officier du génie, et ensuite
comme aide de camp de Joseph Bonaparte. Il avait pris part à la bataille d'Ulm,
à la bataille d'Austerlitz, fait les campagnes d'Espagne et de Russie puis avait
été nommé maréchal de camp à la Restauration. Pendant les Cent-Jours, il avait choisi
d'être à nouveau l'aide de camp de Joseph Bonaparte ; il avait donc été mis
en non-activité au retour de Louis XVIII.
Les sciences
exactes avaient toujours été son étude de prédilection mais, doué d'une extrême
facilité de conception et de la mémoire la plus heureuse, il n'avait négligé
aucune occasion d'augmenter en même temps ses connaissances historiques et
littéraires. L'instruction forte et variée qu'il possède lui permet donc de
tracer avec sûreté la route qu'ont à suivre les élèves de l'École d'état-major.
Seize
officiers généraux lui succéderont à la tête de l’école. Les deux derniers
seront les généraux Gandil et Lewal qui assureront sa transformation en École
militaire supérieure puis en École supérieure de guerre.
Organisation
Son premier
soin, lorsqu'il est appelé au commandement de l’école qui vient d'être fondée, mais
qui n'a point encore d'existence réelle, est de provoquer la réunion, sous sa
présidence, d'une commission chargée de rédiger et coordonner un projet de
règlement du service intérieur de l’école, lequel doit embrasser, dans ses
dispositions étendues, les détails de l'administration, du service, et de la
discipline de l'École.
Ce règlement
provisoire, soumis au maréchal Gouvion Saint-Cyr et approuvé par lui le 7 janvier
1819, est modifié et rendu définitif le 14 du même mois de l'année suivante par
le marquis de Latour-Maubourg, alors ministre de la guerre. Il sera modifié à
différentes époques : le 24 novembre 1828, le 7 mai 1836, le 8 mars 1841,
le 15 avril 1855 et le 20 janvier 1870.
Sous les
ordres du général de brigade commandant l’École, le personnel comprend :
État-major de
l’École :
- Un colonel ou lieutenant-colonel
d’état-major commandant en second et directeur des études ;
- Un chef d'escadron d’état-major
sous-directeur des études, chargé de la surveillance du service intérieur et de
l’instruction théorique sur les manœuvres et les règlements ;
- Trois capitaines d’état-major chargés des
détails du service intérieur et qui concourent à l’instruction des
élèves ;
- Un officier de santé.
Professeurs
militaires :
- Un capitaine ou chef d'escadron d’état-major
professeur de machines et de sciences appliquées ;
- Un capitaine ou chef d'escadron d’état-major
professeur de cosmographie, de géographie physique et de statistique ;
- Un chef d'escadron ou chef d'escadron d’état-major
professeur de géodésie et de topographie
- Un capitaine ou chef d'escadron du génie professeur
de fortification ;
- Un capitaine ou chef d'escadron
d’artillerie professeur de cette arme ;
- Un sous-intendant professeur de législation
et d’administration militaire ;
- Un capitaine ou chef d'escadron
d’état-major professeur d’art militaire ;
- Trois professeurs adjoints : un
adjoint au professeur de machines et de sciences appliquées chargé d’aider le
professeur d’artillerie ; un adjoint au professeur de topographie et de
géodésie chargé d’aider le professeur de géographie ; un adjoint au
professeur de fortifications chargé d’aider le professeur d’art
militaire ; les professeurs adjoints sont en outre chargés de la conduit
des travaux topographiques sur le terrain.
- un chef d'escadrons de cavalerie, écuyer en
chef, professeur d’équitation et d’hippologie ayant sous ses ordres : un
capitaine de cavalerie instructeur chargé de l’instruction militaire à
cheval ; un capitaine de cavalerie écuyer chargé de la surveillance du
matériel de manège et de la direction du petit état-major.
.png)
Ecole d'application d'état-major - le manège (1851)
Professeurs
civils :
Deux professeurs de dessin ;
Un professeur de langue allemande et un professeur
adjoint ;
Un professeur de langue italienne (rapidement
supprimée) ;
Un professeur d’escrime.
Hormis en fin
de période, la médiocrité du corps professoral est relevée à plusieurs
reprises ; certains professeurs y effectuent toute leur carrière et l’un
des premiers soucis des réformateurs de l’École supérieure de guerre sera de
bouleverser les habitudes en renouvelant totalement l’encadrement de l'École.
Employés :
Un trésorier
secrétaire, bibliothécaire et archiviste et un commis aux écritures.
Personnel de
service :
Un portier,
deux garçons de salle, un tambour ou clairon, un homme de peine.
Personnel du
manège :
Un
sous-lieutenant ou lieutenant du service des remontes, commandant le
détachement des cavaliers de remonte et des cavaliers de manège, également
officier de casernement et directeur des ordinaires ; un vétérinaire de
1re classe ; un petit état-major (un adjudant maître de manège, deux
maréchaux-des-logis sous-maîtres, un brigadiers et cinq maréchaux ferrants).
Cette
organisation ne variera pas pendant toute l’existence de l’école (1818-1878)
Localisation :
Jusqu’en 1823,
l’École est installée dans un hôtel loué au marquis de La Briffe, aux nos 2 et
4 de la rue de Bourbon (actuelle rue de Lille), à Paris.
Comme les
locaux mis à sa disposition étaient insuffisants, on s'avisa que l'hôtel de
Villeroy, au 26, rue de Varennes, avec ses vastes dépendances nouvelles,
pourrait facilement la recevoir, et, au milieu de l'année 1822, le conseil de
santé des armées recevait l'ordre de lui céder la place ; l’École y reste
jusqu’en 1827.
A partir de
1842, elle se trouve dans l'ancien hôtel de Sens, rue de Grenelle.
Élèves :
Les modalités
d’admission des élèves fixées initialement par l’ordonnance du 6 mai 1818 varieront à plusieurs reprises pour s’adapter aux besoins du temps de
paix ou du temps de guerre : les ordonnances du 23 février 1833 et du 24
avril 1858, le décret du 8 juin 1861, les décisions ministérielles des 20 et 21
juillet 1861, la note du 22 juillet 1861 et la dernière, la note du 6
juin 1872.
Le ministre
détermine chaque année, d'après l'ordre successif des numéros de sortie, le
nombre des élèves qui seront admis, sur leur demande, à concourir pour les places
de sous-lieutenants élèves à l'École d'application d'état-major. Le nombre des
candidats est, en principe, double de celui qui doit former, pour l'année, le
recrutement de l'École. Ils sont choisis parmi ceux de l’École spéciale
militaire et de l’École polytechnique susceptibles d’obtenir le brevet de
sous-lieutenant, ainsi que parmi les sous-lieutenants de l’armée. Ils ne sont
admis que par voie de concours.
Les examens
sont subis devant une commission spéciale désignée par le ministre de la guerre.
Le programme est le même que celui de sortie de Saint-Cyr, auquel s'ajoutent des
épreuves écrites, des fragments de dessin exécutés
sous les yeux de la commission et, enfin, des examens équestres propres à faire
constater sous ce rapport l'aptitude de chaque candidat au service spécial
d'état-major.
Ces principes
consacrent une régularité certaine dans le recrutement mais cachent mal des
passe-droits et des anomalies qui entretiendront un débat de fond pendant toute
l’existence de l’École et du corps d’état-major.
- Variation d’une année sur l’autre de
l’effectif choisi ; l’effectif moyen d’une promotion s’établit autour de
trente stagiaires et s’avère, sur la longue durée, insuffisant ;
- Places réservées, sans concours d’entrée,
aux polytechniciens ;
- Élèves surnuméraires sans conditions
d’entrée imposés par la cour jusqu’au milieu du XIXe siècle ;
- Suspicions autour des épreuves du concours
d’entrée qui, selon certains, « avaient
pour but principal de se débarrasser des élèves dont on ne voulait pas. »
Les officiers
élèves passent deux ans à l’école et sont répartis en deux divisions, ceux
entrant à l’école formant la deuxième division. L’officier élève qui figure le
premier sur la liste de classement de chaque division en est le chef.
Une liste des promotions est proposée par ailleurs.
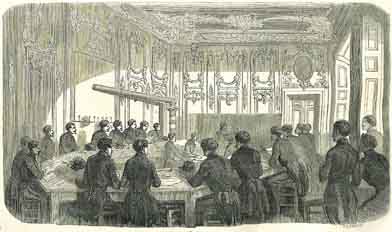
Ecole d'application d'état-major - salle des cours (1851)
Enseignement :
L'enseignement
comporte des mathématiques, de la géométrie descriptive, de la physique, de la
chimie, de la cosmographie, de la géographie, de la topographie, des cours
d'artillerie, des études des différentes forteresses, une instruction théorique
et pratique sur les manœuvres de cavalerie et d'infanterie. L'élève doit aussi
se perfectionner, en équitation, en danse, en escrime, en langues étrangères,
connaître tous les règlements de l'administration militaire. Ajoutons à cela
l'histoire des peuples, l'histoire des guerres, l'art militaire, la
littérature, le latin et la rhétorique, sans oublier bien entendu les
différents travaux graphiques.
Après ce
temps, les élèves qui ont satisfait aux examens, sont appelés, dans l’ordre de
leur numéro de sortie, à accomplir des stages dans les régiments d’infanterie,
de cavalerie et d’artillerie de l’armée. Ce n’est qu’après ces stages qu’ils
remplissent des fonctions d’officiers d’état-major.
La scolarité
ne semble pas avoir laissé des souvenirs impérissables dans les mémoires des
officiers du XIXe siècle qui insistent plus volontiers sur leur carrière en
Afrique. D’autres stigmatisent l’aspect théorique d’études où la pratique
n’excède jamais un quart de l’emploi du temps en deuxième année.
Le régime des
études est peu contraignant, la discipline approximative, la vie hors service
souvent très mondaine et d’une grande liberté pour des élèves en général
financièrement à l’aise et qui, une fois titularisés, bénéficieront d’avantages
de solde significatifs par rapport à leurs camarades des régiments.
Cassaigne,
aide de camp du maréchal Pélissier à Sébastopol et élève de l’École en
1838-1839, écrit : « Il est
vrai aussi que nous avons bien des ennuis et qu’un jeune officier se soucie
fort peu de faire chaque jour quelques heures d’architecture ou de construire
des cadrans solaires. »
Le colonel Fix,
élève en 1848-1849, décrit le régime des études : « Neuf heures d’exercices journaliers dont deux pour l’équitation,
et sept pour les études, leçons et travaux graphiques qui avaient une
singulière importance ; toute la partie de l’officier du génie y était
abordée ainsi que le dessin, le levé à vue, la géodésie et l’astronomie. »

Ecole d'application d'état-major - une chambre d'élèves (1851)
Globalement
boudée par les bouillants officiers soucieux d’aller guerroyer en Afrique,
critiquée et jalousée, l’École n’en est pas moins le creuset où s’initient des
carrières parfois brillantes et aussi exceptionnellement rapides.