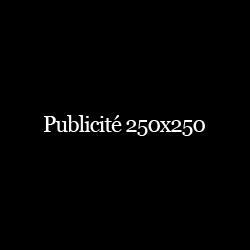LE CENTRE DES HAUTES ÉTUDES MILITAIRES
LES ORIGINES : LA TROISIÈME ANNÉE DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE 1909-1910
Le 5 août 1909, le général Brun autorise le général Foch qui commande l’École supérieure de guerre à entreprendre « à titre d’essai » le complément d‘information que celui-ci juge indispensable.
Élaboré rapidement, le programme est approuvé le 27 septembre 1909. Il vise essentiellement à former des officiers aptes à servir dans les états-majors d’armées. Trois parties principales constituent ce programme :
- Les bases de la conduite de la guerre, le bilan des forces et des intérêts au point de vue politique, géographique, financier et militaire.
- La théorie de la stratégie moderne et de la guerre d’armées.
- La technique de la guerre d’armées.
Cette troisième année d’école, qui se déroule du 15 novembre 1909 au 12 octobre 1910, intéresse les quinze premiers du classement de sortie soit DE GALBERT, THOMAS, KOECHLIN, FOURNIER, FAURE, BILLOTTE, SOURDOIS, DEROUGEMONT, LAGRUE, MARTIN, TANANT, BONNET, DOUMENC, DUCASSE et BOUCHERIE.
L'application du programme sur le terrain comporte un voyage d’état-major dirigé personnellement par le général Foch, un exercice d’ensemble du service des arrières, des visites du camp retranché de Verdun, d’installations ferroviaires, d’établissements de l’artillerie et de l’aérostation. Enfin les stagiaires prennent part aux grandes manœuvres d’automne de 1910. En outre, ils ont à présenter un mémoire personnel devant une commission présidée par le chef d’état-major de l’armée.
Cette création fait l’objet de vives critiques, non pas tant pour l’enseignement dispensé qu’en ce qui concerne son principe même et la qualité des stagiaires. En effet, les lois et règlements ne prévoient que deux années d’études à l’École supérieure de guerre et on reproche aux stagiaires d’être trop jeunes et de trop peu d’expérience. D’autre part, le stage d’état-major de deux ans consécutif aux cours de l’École supérieure de guerre est pour eux réduit à un an.
Une nouvelle formule est donc envisagée qui aboutit, par une instruction ministérielle du 21 octobre 1910, à la création du Centre des hautes études militaires.
Le texte ci-dessous présente l'intervention du colonel Jean DEFRASNE de la 54e promotion, membre de la commission française d'histoire militaire, sur la troisième année de l'Ecole supérieure de guerre, au colloque du Centenaire de l'Ecole supérieure de guerre, les 13 et 14 mai 1976.
*
* *
Un mot d'explication sur l'origine de cette communication. Après avoir pris ma retraite en 1961, je servis pendant environ cinq ans à la Confédération des travailleurs intellectuels de France, où j'eus à m'initier à beaucoup de problèmes intéressant notamment les cadres et les professions libérales. Ayant quitté ces fonctions pour me consacrer à l'Histoire, je reçus, comme témoignage de bons services un autographe du maréchal Foch : une lettre adressée le 21 mai 1910 à un ami qui venait de défendre dans un journal les idées du futur maréchal sur l'enseignement militaire supérieur.
Voici ce texte :
« Mon cher ami,
Je viens de lire ton lumineux et large article sur notre troisième année d'études. Enfin il y a quelqu'un pour voir au-dessus des personnes, et du particulier, les intérêts généraux de notre armée qui sont bien liés avec ceux du pays, pour se douter que n'ayant pas plus que nos voisins la science infuse, si nous ne travaillons pas dans une Europe en plein travail, nous finirons par jouer les ignorants, que les grandes institutions, le commandement, pour être à hauteur de leur tâche de plus en plus vaste et compliquée doivent apprendre et non se contenter de tenir des emplois, que l'on étudie pas à tout âge...
Pour si lapalissades que soient ces vérités, nous mettrons un certain temps à les faire admettre : elles troublent la quiétude de ceux qui ne veulent ou ne peuvent travailler.
En continuant de dire la vérité, nous empêcherons qu'on l'enterre, elle finira par triompher. Merci de la si bien défendre, et l'assurance, mon cher ami, de mes meilleurs sentiments. »
Signé : Foch
Je pars le 23, rentrerai le 27.
Repartirai le 29, id le 3 juin.
A bientôt j'espère. »
Je ne croyais pas possible d'identifier le destinataire sans de longues recherches particulières lorsque Mme Fournier-Foch, au cours de l'entrevue qu'elle a bien voulu m'accorder il y a quelques jours, m'a suggéré le nom du lieutenant-colonel Rousset, ancien professeur adjoint au cours d'infanterie de 1893 à 1895, puis chef du cours d'infanterie de 1896 à 1900. Celui-ci quitta alors l'armée et s'orienta vers la politique et le journalisme. Cette hypothèse paraît donc particulièrement plausible. Tout, même le tutoiement, devient alors clair.
J'avais de toute manière conçu un vif intérêt pour cette création d'une troisième année d'études à l'École supérieure de guerre, me promettant d'étudier à l'occasion ce problème : cette occasion, les organisateurs du présent colloque ont bien voulu me la fournir et je les en remercie vivement.
Lorsque Foch écrit cette lettre, il a déjà réussi à faire adopter ses idées, puisque la troisième année de la 33e promotion (1907-1909) est en cours. En effet, il a emporté la décision auprès du général Brun, ministre de la Guerre, auquel il avait écrit : « Dans l'ensemble de la guerre, il y a des situations stratégiques à éclaircir, à asseoir. Et ces situations stratégiques, par leur étendue, leur configuration, leurs voies de communication, diffèrent absolument des situations tactiques envisagées pour la bataille... Elles sont faites de grandeurs particulières. Le grand commandement doit disposer d'aides capables d'étudier ces situations et suffisamment informés pour pouvoir les comprendre et les traiter en sous-ordres. Il faut les préparer. »
C'est le 5 août 1909 que le général Brun donne l'autorisation, d'entreprendre « à titre d'essai », ce complément de formation jugé indispensable par le commandant de l'École de guerre.
Nous allons voir ce que contenait le programme des études, et à qui il était destiné. Élaboré rapidement, il fut approuvé le 27 septembre 1909. Il visait essentiellement à former des officiers aptes à servir dans les états-majors d'armées, celles-ci, d'après Foch, étant destinées à jouer un rôle comparable à celui joué sous l'Empire par les corps d'armée. Pour simplifier l'exposé, nous indiquerons, à mesure que nous énumérerons les parties du programme, qui fut chargé de l'enseignement. Et nous devons ici faire allusion aux « officiers supérieurs stagiaires », souvent mis à contribution, et qui pensons-nous, représentent les futurs professeurs adjoints de l'École.
Trois parties principales dans le programme :
1) Les bases de la conduite de la guerre, le bilan des forces et des intérêts au point de vue politique, géographique, financier et militaire, « la guerre ne devant être entendue que comme le prolongement de la politique extérieure », cette phrase ne manquera pas, je pense, de faire dresser l'oreille aux clausewitziens présents !
Citons ici les cours de géopolitique du colonel Krien, les leçons sur les conséquences économiques, financières et sociales de la guerre, par le capitaine Serrigny, futur secrétaire général de la Défense nationale, les études du commandant Hucher sur la statistique militaire et du capitaine Duval sur l'armée japonaise.
2) La théorie de la stratégie moderne et de la guerre d'armées, illustrées par des études sur les situations de 1813-1814, de la guerre d'Amérique (au sens vraisemblablement de guerre de Sécession), de 1866, de 1870-1871, de la guerre de Mandchourie ; les principaux auteurs étudiés sont Napoléon, Moltke, Von der Golz, Blume, Von Schlichting, Oyama. L'histoire et la stratégie paraissent ici étroitement mêlées avec les exposés des commandants Colin, de Corn, des Vallières, du lieutenant-colonel Cordonnier, des commandants Mordacq et Lebouc.
3) La technique de la guerre d'armées, avec les marches (commandant Ragueneau), l'alimentation et l'habillement (sous-intendant Laurent), les munitions (lieutenants-colonels Paloque et Besse), le service de Santé, (médecin principal Boisson), les communications et les transports (commandant Biais) avec mention des transports automobiles (capitaine Ecochard).
Les applications sur le terrain comportèrent un voyage d'état-major, dirigé personnellement par Foch ; d'après Weygand, un officier stagiaire y avait été frappé par « l'initiative hardie et féconde » que représentait l'envoi par télégrammes des ordres et des décisions. En outre les stagiaires participèrent à un exercice d'ensemble du service des arrières, à des visites au camp retranché de Verdun, à des installations ferroviaires, pour l'initiation aux transports en cours d'opérations, à des établissements de l'artillerie et de l'aérostation. Ils prirent part dans un état-major aux grandes manœuvres d'automne de 1910.
Enfin, ils eurent à présenter un mémoire personnel — dont nous reparlerons — devant une commission présidée par le chef d'état-major de l'armée.
Cette troisième année d'École de guerre, ouverte le 15 novembre 1909, a intéressé les quinze premiers du classement de sortie de la 33e promotion, composée de cent officiers stagiaires ; les études, essentiellement consacrées à la manœuvre de la division et du corps d'armée — ainsi qu'en témoigne le général Loizeau, — avaient été dirigées par des professeurs hors de pair, les Maunoury, Foch, Maud'huy, Pétain, Champeaux, Fayolle, Toulorge...
Voici les noms des quinze stagiaires de troisième année : capitaine Billotte, capitaine Bonnet, capitaine Boucherie, lieutenant Derougemont, lieutenant Doumenc, lieutenant Ducasse, capitaine Faure, lieutenant Fournier, capitaine de Galbert, capitaine Koechlin, capitaine Lagrue, lieutenant Martin, lieutenant Sourdois, capitaine Tanant, capitaine Thomas. Pour la petite histoire, le général Tanant, dans les Mémoires laissées pour ses enfants, dit qu'il obtint le n° 10 ; quant au futur général Loizeau, sorti seizième, il prétend avoir été reculé de quelques rangs, ainsi qu'un lieutenant, « pour permettre à des camarades plus considérés de pénétrer dans le cénacle des stratèges ».
Il ne saurait être question, dans une si courte étude, de se livrer à une étude exhaustive de ces quinze officiers, ce qui nécessiterait des recherches approfondies. Mais vous penserez par contre qu'il serait regrettable de ne rien dire d'eux.
Nous pouvons savoir à quelles questions ils s'intéressaient par le sujet des mémoires que nous avons mentionnées.
Deux seulement de ces travaux sont consacrés aux campagnes de 1866 et 18 70 et un à la guerre de Sécession, deux touchent à la doctrine et à la stratégie mais tous les autres se rapportent aux événements très contemporains : deux sur la Belgique, deux sur la Suisse, les « ailes » du théâtre d'opérations du nord-est, deux sur le monde slave et trois sur les guerres balkaniques, le dernier enfin, celui du capitaine Billotte porte sur la défense de l'Indochine. Nous ne savons si ces travaux ont été conservés, mais leur lecture serait certainement fort intéressante.
A noter qu’un des stagiaires, capitaine d’artillerie déjà ancien, Koechlin, avait figuré comme conférencier parmi le corps professoral ; il avait traité de l'École d'état-major anglaise ; peut-être y avait-il effectué un stage. Nous avons retrouvé à la bibliothèque de notre école un ouvrage de lui, publié en 1907, sur Les ordres de la couronne de fer et de la couronne d'Italie. Cet officier cultivé accomplissait son temps de commandement de chef d'escadron à Saint-Mihiel en 1914, et nous n'avons jusqu'ici rien recueilli sur sa carrière postérieure.
Il semble inutile de parler de Billotte, servant successivement au cabinet militaire de Lyautey, au bureau des théâtres d’opérations extérieurs, lorsqu'il fut créé au Grand quartier général, et puis gravissant tous les degrés de la hiérarchie. On sait qu'il mourut en 1940, à un moment crucial, dans un accident d'automobile. En 1914, Derougemont, Fournier, Sourdois, et Thomas sont tous quatre stagiaires à l'état-major de l'armée ; Fournier, le futur gendre de Foch, après un temps de commandement aux chasseurs de Saint-Nicolas-du-Port, effectue un stage au 4e bureau de l'état-major de l'armée, ce qui lui vaut de servir dans des régulatrices à la mobilisation ; affecté plus tard à l'état-major de Foch, promu chef de bataillon, il commandera le 15e bataillon de chasseurs en Italie, servira ensuite dans divers états-majors, dont celui de Mangin à l'armée du Rhin. Décédera comme colonel en 1929, 15 jours après son beau-père. Derougemont, appelé au TOE du GQG, auprès de Billotte est qualifié par Pierrefeu, critique pourtant très sévère, « un des plus brillants officiers de l'ESG ; cerveau éminemment ouvert et souple, capable de tout assimiler en peu de temps ». Ses séjours dans les états-majors sont coupés par un temps de commandement à la tête du 3e bataillon de chasseurs, de juillet à décembre 1917. C'est le même, je pense, qui occupe en 1931 le poste d'adjoint au directeur de l'infanterie.
De Galbert est auprès de Joffre en 1914 ; c'était déjà un de ses collaborateurs d'avant-guerre. Pierrefeu le juge comme « un beau caractère, un peu fier et hautain, nourri de la plus haute morale militaire ». Il sera tué sur la Somme à la tête du 13e bataillon de chasseurs.
Tanant, promu chef de bataillon, est en 1914 affecté à l'état-major du général Ruffey, désigné pour le commandement de la 3e armée ; c'est probablement l'officier le mieux utilisé dans l'esprit des études de la troisième année d'École de guerre : chef de 3e bureau d'armée et rapidement chef d'état-major, avec Sarrail, puis avec Humbert, dont il fut le précieux collaborateur. Il est jugé par Pierrefeu comme un excellent organisateur. On sait qu'il commanda successivement après la première guerre mondiale l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, la 43e division d'infanterie de Strasbourg et la 10e région militaire de Rennes. Il écrivit plusieurs ouvrages comme L'officier de France, et Plutarque n'a pas menti.
Lagrue, détaché comme chef de bataillon à la section Écoles de l'état-major de l’armée en 1914, fut après la guerre directeur de l'infanterie et commanda lui aussi une région militaire : la 12e de Limoges.
Le capitaine Boucherie est affecté comme chef (et seul officier) du 1er bureau du corps de cavalerie Sordet. Rappelons qu'il n'y avait pas alors de 4e bureau, que le corps de cavalerie n'était pas doté de services, et que la cavalerie devait normalement vivre sur le pays ; c'est dire que Boucherie, éclairé par ses études de troisième année, eut certainement à faire preuve d'une très grande initiative. Le général Boucherie commandait en 1932 une brigade de cavalerie.
Le capitaine Faure n'était-il pas cet artilleur qui tint jusqu'à l'automne 1917 l'historique du GQG ?
Terminons par Doumenc, qui commandait en 1914 une batterie à Troyes ; profitant de l'information reçue en troisième année, il s'occupa de transports automobiles au GQG et fut l'artisan des convois de la Voie Sacrée ; il exprima après la guerre des idées d'avenir sur cette question dans des revues et des ouvrages ; on le retrouve dans les années 30 chef du 4e bureau, puis sous-chef de l'état-major de l'armée. Enfin, personne n'a oublié le major-général de la seconde guerre mondiale.
L'intérêt de la troisième année d'École de guerre réside dans ce fait qu'elle fut incontestablement à l'origine de la création du Centre des hautes études militaires. En effet, la troisième année avait fait l'objet de vives critiques, non pas tant pour l'enseignement dispensé qu'en ce qui concerne son principe même et la qualité des stagiaires.
La création eut très mauvaise presse à la Chambre, très à cheval sur les lois et règlements, qui ne prévoyaient que deux années d'études. N'oublions pas, messieurs, qu'il n'était pas question, à cette époque de supprimer une région militaire d'un trait de plume, et que la création d'un seul régiment nécessitait une loi.
D'autre part, le stage d'état-major réglementaire était réduit à un an pour les élèves de troisième année. Et surtout, on reprochait aux stagiaires d'être trop jeunes et de trop peu d'expérience, certains d'entre eux n'ayant pas encore obtenu leur troisième galon. Notons cependant que la moyenne d'âge pour les quinze « privilégiés » était d'environ trente-trois ans.
Quoi qu'il en soit, une nouvelle formule fut envisagée. L'enseignement militaire supérieur s'appliquerait à des hommes plus mûrs et plus expérimentés, mais encore jeunes commandants au tableau d'avancement et quelques lieutenants-colonels récemment promus.
Il n'y aurait ni examen, ni classement et le brevet d'état-major ne serait pas exigé. La direction de l'instruction incomberait au chef d'état-major général de l'armée, assisté du commandant de l'École de guerre. Les officiers, seulement détachés de leur corps ou emploi, le rejoindraient après les manœuvres d'automne, auxquelles ils participeraient comme arbitres.
Le décret du 21 octobre 1910 vint confirmer ces dispositions, qui entrèrent en vigueur, avec la première session, en février 1911. Weygand, qui devait suivre le troisième cours, a confirmé que le programme du CHEM reprenait dans son ensemble celui de la troisième année d'École de guerre, sous la forme de trois mois de conférences et de travaux sur la carte, suivis de trois mois d'exercices de cadres sur le terrain et de visites de caractère géographique et économique.
Ayant ainsi établi la filiation évidente entre troisième année d'École de guerre et CHEM, nous pensons qu'il conviendrait maintenant d'aborder la perspective générale des études stratégiques et de la formation technique des officiers appelés à servir dans des états-majors de haut-rang.
C'est par une sinusoïde que pourrait le mieux être représentée la courbe de l'impulsion donnée à ces études au cours des deux années normales d'École de guerre ; les variations apparaissent au simple vu des titres de certains cours.
En 1892, par exemple, Bonnal est chef du cours d'Histoire militaire, de stratégie et de tactique générale ; et au voyage de 1890, qu'il a organisé avec le colonel Maillard, on fait intervenir l'armée et on apprend à rédiger des ordres à cet échelon.
Quelques années plus tard, on retournera vers la tactique.
Mais le commandant puis lieutenant-colonel Foch sera lui aussi professeur de stratégie et de tactique générale de 1896 à 1901.
Le colonel Verraux traitera de problèmes stratégiques et le lieutenant-colonel Toulorge donnera un cours sur les services de l'arrière.
En 1908, quand Foch prend le commandement de l'École, la stratégie n'est qu'à peine abordée et c'est parce qu'il estime précisément que le temps disponible n'est pas suffisant qu'il arrivera à la conception de la troisième année.
Après la première guerre mondiale, on se cantonna généralement dans l'étude de la division et du corps d'armée. C'est vrai aussi bien pour la promotion du général Humbert en 1921-1923 que pour la mienne une dizaine d'années plus tard, si j'excepte quelques conférences du commandant en second, le général Loizeau, sur la manœuvre de l'armée, conséquence peut-être du regret de n'avoir pu participer à la troisième année de la 33e promotion ? « Ce n'est pas à cinquante ans, messieurs, nous disait-il, qu'il faut aborder les études stratégiques. » Et il y avait certainement là une critique indirecte du CHEM, écarté de sa vocation première, ses disciples n'étant plus des commandants, mais des colonels.
En fait, comme en témoigne le général Humbert, les officiers brevetés dans l'immédiat après-guerre et accédant à la veille de la seconde guerre aux postes des hauts états-majors n'avaient bénéficié ni d'une instruction, hors celle acquise sur le tas au 4 bis[1], ni d'un recyclage les préparant directement à leurs fonctions.
Ceci avait été ressenti en haut lieu, car une génération plus jeune put bénéficier des études du cours technique d'armée, vite baptisé « Petit CHEM ». Il fonctionna apparemment pendant cinq ans, de 1934 à 1938, pour des promotions de vingt-cinq officiers environ. Que nous en disent des témoins, comme le colonel Clogenson ? « Le programme, très chargé, véritable épreuve physique, comportait surtout des études à l'échelon armée, sous forme de courts travaux de 3e et 4e bureaux. » Rappelons encore que certains officiers sortant de l'École de guerre accomplissaient le début de leur stage aux 2e et 4e bureaux de l'état-major de l'armée, ce qui constituait certainement un complément de formation en matière de renseignement, et de transports. Convient-il aussi de mentionner le rôle du Centre d'études tactique interarmes ? Nous le pensons, depuis que nous avons appris qu'il ne servait pas seulement à préparer des officiers supérieurs à exercer un commandement, mais aussi à donner une information aux futurs auditeurs du CHEM. Il serait également utile de connaître le niveau d'instruction d'organismes comme le Centre d'études tactiques d'artillerie de Metz où les stagiaires de l'Enseignement militaire supérieur effectuèrent des séjours.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la situation se modifie avec la création du Cours supérieur interarmées. Remarquons d'emblée que ce cours, dans le temps, ne peut nullement être rapproché de la troisième année, puisqu'au contraire il se situe en début de seconde année et constitue donc un prélèvement sur les deux années normales. Par ailleurs, comme le dit sa dénomination, il est essentiellement consacré aux problèmes de liaison et collaboration interarmées qui se posent non seulement lors d'opérations spécifiquement « combinées », mais encore pour toutes opérations d'ensemble sur un théâtre d'opérations. Dès lors, la « technique d'armée » ne peut y avoir qu'une place restreinte ; il semble toutefois que vers le début des années 50, cette discipline ait été sérieusement abordée au cours de la seconde partie de la deuxième année : c'est le témoignage du colonel Annequin. Il est certain que, là encore, c'est la sinusoïde qui rend le mieux compte de l'évolution de l'instruction dans ce domaine au cours des dernières décennies.
Parti d'un simple document, nous avons déroulé devant vous le cheminement de notre pensée, en vous montrant que la question de cette très éphémère troisième année à l'École supérieure de guerre ne constituait pas un problème de mince importance.
Certains des aspects examinés méritent certainement encore de retenir l'attention des chefs qui, de nos jours, ont la responsabilité de l'Enseignement militaire supérieur.
Et je désirerais en terminant exprimer mes remerciements à ceux qui m'ont aidé pour la rédaction de cette communication : en tout premier lieu les officiers du cours d'histoire de l'École de guerre et le colonel Annequin, le très érudit secrétaire général de l'Association des Amis de l'École de guerre, et aussi le général Humbert, le général Schuhler, ancien directeur du Cours supérieur interarmées et le colonel Clogenson, ancien auditeur du Cours technique d'armée.
[1] 4 bis pour 4 bis, boulevard des Invalides : Expression consacrée pour désigner le siège des états-majors réduits attribués dès le temps de paix aux généraux destinés à exercer des commandements d'armée en temps de guerre.
*
* *
LE CENTRE DES HAUTES ÉTUDES MILITAIRES DE 1911 À 1914
En janvier 1911, débute à Paris, dans les locaux de l'Ecole supérieure de guerre, la première session du Centre des hautes études militaires. Le centre est placé sous la direction du chef d'état-major général de l'armée avec comme adjoint le commandant de l'Ecole supérieure de guerre.
La session 1911 accueille environ 25 officiers supérieurs, détachés de leurs corps ou services.
Il s’agit désormais d’une formation indépendante de six mois, distincte de celle donnée par l’ESG. La formule finalement retenue vise, selon les termes de Foch, à « éprouver un certain nombre d’officiers supérieurs (lieutenants-colonels), désignés par leur passé et leur âge pour arriver aux grades les plus élevés de l’armée, et [à] leur donner les connaissances, leur faire connaître la nature des travaux à envisager dans le haut commandement. Par là, préparer le recrutement de ce haut commandement ».
Essentiellement pratiques, les travaux sur carte, mais aussi sur le terrain, visent à initier les auditeurs au fonctionnement de l’armée et du groupe d’armées. Des conférences d’intérêt général portant sur la doctrine, l’organisation, les transports, mais aussi sur les armées étrangères, viennent enrichir l’ensemble.
La circulaire d'octobre 1910 est complétée par celle du 27 août 1912 : dorénavant, les stagiaires sont convoqués à Paris du 10 janvier au 8 juillet de chaque année ; ils participent dans la deuxième quinzaine de juillet ou la première d'août à un voyage d'état-major, et prennent part aux manœuvres d'automne.
Parmi les « chemistes » d'avant 1914, on relève la présence du colonel Henri Gouraud (session 1911) ou du lieutenant-colonel Maxime Weygand (session 1913), futures figures de l’armée française. Leur recrutement illustre le fait que tous les auditeurs ne sont pas tous déjà brevetés : les textes l’interdisent d’ailleurs expressément. Le CHEM est ainsi, pour certains officiers, l’occasion de décrocher une qualification académique supérieure, à une époque où les diplômes prennent une place croissante dans le processus de formation et de sélection des chefs militaires.
Le centre y gagne rapidement son surnom : « École des maréchaux ».
Les stagiaires du Centre des hautes études militaires entre 1911 et 1914
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1911
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1912
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1913
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1914
*
* *
LE CENTRE DES HAUTES ÉTUDES MILITAIRES (1919-1939) ET LA GÉNÉRALISATION DU SYSTÈME AUX AUTRES ARMÉES
La guerre a entraîné la fermeture de l’École supérieure de guerre et du Centre des hautes études militaires.
Par circulaire du 10 décembre 1919, Georges Clémenceau, président du Conseil, ministre de la Guerre, décide de réorganiser le Centre des hautes études militaires. Le centre sera installé dans des locaux à l'Ecole militaire ; il fonctionnera du 1er février au 31 juillet et aura essentiellement pour objet, non pas de former des officiers d'état-major, mais de doter les officiers supérieurs qui y seront appelés des connaissances générales indispensables à la conduite de la guerre moderne.
Georges Clémenceau insiste sur l’importance nouvelle qui doit être accordée à la stratégie. De même, l’enseignement de la « science militaire » doit être complété par « des conférences portant sur les grandes questions politiques, économiques et sociales qui exercent leur influence sur la conduite de la guerre ».
Une trentaine d’officiers supérieurs sont désormais accueillis au CHEM, dans des conditions de recrutement et d’emploi identiques à celles de l’avant-guerre.
Le Centre des hautes études militaires redevient une voie privilégiée pour accéder aux étoiles.
Les stagiaires du Centre des hautes études militaires entre 1920 et 1939
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1920
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1921
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1922
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1923
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1924
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1925
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1926
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1927
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1928
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1929
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1930
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1931
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1932
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1933
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1934
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1935
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1936
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1937
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1938
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1939
- Les stagiaires du Centre des hautes études militaires en 1940
Le stage technique d’armée
A la fin des années 20, les officiers brevetés dans l'immédiat après-guerre accèdent aux postes qui leur sont destinés dans les états-majors des membres du Conseil supérieur de la guerre – chargés de mettre sur pied les états-majors d’armées en cas de mobilisation ; ils n’ont pourtant bénéficié ni d’une instruction, hors celle acquise sur le tas, ni d'un recyclage les préparant directement à leurs fonctions.
Ceci est ressenti en haut lieu, car une génération plus jeune peut bénéficier, à partir de 1934, des études du stage technique d'armée.
Placé sous la responsabilité du directeur du Centre des hautes études militaires, ce cours - vite baptisé « Petit CHEM », fonctionne jusqu’en 1938, pour des promotions de vingt-cinq officiers environ (le stage prévu en 1939 n’a pas lieu en raison de la guerre).
Le programme comporte surtout des études à l'échelon armée, sous forme de courts travaux de 3e et 4e bureaux.
- Les stagiaires du stage technique d’armée en 1934
- Les stagiaires du stage technique d’armée en 1935
- Les stagiaires du stage technique d’armée en 1936
- Les stagiaires du stage technique d’armée en 1937
- Les stagiaires du stage technique d’armée en 1938
Un cours de technique d'armée dirigé par le général Baurès est ouvert à Lyon à la fin d'octobre 1942, dans une villa du boulevard des Belges. Il rassemble une dizaine d'officiers supérieurs. Le cours est interrompu par l'entrée des Allemands en zone libre.
Le Centre des hautes études navales
La continuité l’emporte, preuve du succès de la formule initiée avant guerre, que la Marine adopte rapidement. Le décret du 2 mai 1921 remplace l’École supérieure de marine par une École de guerre navale et lui adjoint un Centre des hautes études navales. L’École de guerre navale a pour but « la formation d’officiers d’état-major », tandis que le Centre des hautes études navales prend en charge « la préparation aux hauts commandements ».
À l’image de ce qui prévaut dans l’armée de Terre, les deux établissements sont placés sous la responsabilité du même officier général et regroupés dans un même immeuble à proximité de l’École militaire ; les moyens humains et matériels peuvent ainsi être mis en commun. De même, conférences, mais aussi voyages d’études et exercices sont en partie partagés. Par contre, en dépit de débuts prometteurs, la coopération avec le Centre des hautes études militaires reste modeste.
Choisis parmi les capitaines de vaisseau et les capitaines de frégate, les auditeurs du Centre des hautes études navales suivent une formation de sept mois à partir du début de chaque année civile. Elle devient rapidement une voie privilégiée pour accéder aux étoiles. À la veille de la guerre, la moitié des amiraux en activité est passée par le Centre.
En 1931, le vice-amiral Georges Durand-Viel devient chef d’état-major général de la Marine, après avoir dirigé l’ École de guerre navale et le Centre des hautes études navales en 1927-1929 et avoir été l’un des premiers auditeurs du Centre (session 1923).
Le Centre des hautes études aériennes
Quinze ans après la Marine, la nouvelle armée de l’Air adopte à son tour le système développé par l’armée de Terre.
Le décret du 26 juillet 1936 institue une École supérieure de guerre aérienne et un Centre des hautes études aériennes, tous deux installés à l’École militaire. La mise en place se fait en étroite collaboration avec le Centre des hautes études militaires, tant sur le plan de l’enseignement – dont les principes sont repris – que du soutien administratif et matériel.
Nettement moins développée, la coopération avec le Centre des hautes études navales est cependant réelle.
À la fin des années trente, les effectifs annuels des trois centres approchent la cinquantaine (une trentaine pour le Centre des hautes études militaires, 7 ou 8 pour le Centre des hautes études navales, une dizaine pour le Centre des hautes études aériennes. Les profils varient considérablement d’une armée à l’autre. Quand les brevetés forment au moins la moitié des effectifs du CHEM et du CHEN, ils sont plus rares au CHEA. Celui-ci sert essentiellement à donner une qualification académique supérieure à des officiers qui n’en possèdent pas encore, à l’instar de ce qui prévalait dans les autres centres à leurs débuts.
*
* *
UNE RÉOUVERTURE TARDIVE MAIS DANS UN CADRE UNIFIÉ ET INTERARMÉES (1951)
Alors que le CHEM avait rouvert moins d’un an après la fin du premier conflit mondial, il s’écoule six ans et demi avant qu’il en soit de même après 1945.
Le nouveau CHEM accueille désormais des auditeurs des trois armées. Il constitue même, et pour longtemps, le seul niveau de l’enseignement militaire supérieur à s’inscrire totalement dans un cadre interarmées.
A la Libération, une réflexion globale sur l’organisation de l’enseignement militaire supérieur a été pour la première fois engagée. Cette nouvelle approche est permise par un début d’unification des structures politico-militaires, symbolisé en particulier par la nomination d’un chef d’état-major général de la Défense nationale, le général d’armée Juin, en charge de la dimension interarmées de l’enseignement militaire supérieur. Décidée en octobre 1946, l’unification des écoles de guerre doit donner naissance à une École supérieure des forces armées. La formation postérieure sera assurée par un Centre des hautes études de défense nationale et d’économie de guerre, qui prendra finalement le nom d’Institut des hautes études de la défense nationale. Sa première session débutera dès la fin octobre 1948. A l’inverse, l’affaiblissement de la fonction de chef d’état-major général de la Défense nationale, combinée aux dissensions interarmées, entraîne l’ajournement du projet d’École supérieure des forces armées.
Au début des années cinquante, celui-ci est définitivement enterré. Seul subsiste un cycle d’enseignement commun, le Cours supérieur interarmées (CSI), d’une durée de six mois, qui complète la formation donnée dans les écoles de guerre.
En complément est alors décidée la résurrection des centres des hautes études dans un cadre unifié, reprenant le nom du plus ancien des trois établissements, également le seul polyvalent. Tardive, cette réouverture est ainsi pionnière. Elle l’est également sur d’autres plans. Désormais, les auditeurs du CHEM sont invités à suivre en parallèle les activités de l’IHEDN. Autre rupture, et de taille, le nouveau centre ne vise plus à préparer les auditeurs à des responsabilités dans le seul cadre national. Un impératif d’autant plus fort qu’est créé, au même moment, également sur le site de l’École militaire, le Collège de défense de l’OTAN, dont la direction est confiée au vice-amiral d’escadre Lemonnier, ancien directeur de l’IHEDN (1950-1951).
Pour autant, le CHEM reste à l’usage exclusif des officiers français : il faudra attendre le siècle suivant pour y voir accueillis des auditeurs étrangers.
Le nouveau centre s’installe dans les locaux qui sont encore aujourd’hui les siens, au 21 place Joffre. Il est placé sous l’autorité directe du comité des chefs d’état-major, que préside le général Juin (maréchal en juillet 1952), inspecteur général des forces armées.
Dans les années qui suivent sa réouverture, le centre n’accueille plus que trente-six auditeurs en moyenne, soit un tiers de moins que ses prédécesseurs à la veille de la guerre. Une évolution à rapporter à la rupture qu’a constitué l’effondrement de 1940 et dont témoigne la chute du nombre d’officiers généraux des armes. Ils étaient 424 à la veille de la guerre, ils ne sont plus que 230 en 1947…